Gestes d’écrire
Gilles Bonnet, Erika Fülöp, Gaëlle Théval, « Gestes
d’écrire », Qu’est-ce que la
littéraTube ? (édition augmentée), Les Ateliers de [sens
public], Montréal, 2023, isbn : 978-2-924925-21-8, http://ateliers.sens-public.org/qu-est-ce-que-la-litteratube/chapitre6.html.
version 0, 22/05/2023
Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
« Voir, Penser, Écrire, cela revient au même. Et cela
passe par la vidéo »
(Dubois 2012,
237)
Les (quasi-)genres émergents que nous avons identifiés dans l’espace littéraire de YouTube pour des raisons pratiques restent fluides et ouverts les uns sur les autres. En sus des critiques, des lectures, des performances et des journaux, les diverses rencontres entre le médium et les scripteurs ont donné lieu à toute une gamme d’autres écritures fines et singulières : de la poésie et des récits vidéo, des fictions et des réflexions poétiques audiovisuelles qui suivent une autre logique. Elles ne sont pas sans lien avec les genres mentionnés, et une grande partie de ce que nous avons observé à propos du corps, de la voix et de l’écrit dans l’image au cours des chapitres précédents vaudra ici aussi, sans toutefois que l’on puisse les ranger sous les mêmes étiquettes. Ces œuvres en constante évolution mériteraient d’être traitées en tant que telles, dans le sens collectif des « œuvres complètes » de leur auteur ou autrice, suivant la logique organique interne propre à chacune. Ici, nous ne proposerons qu’une traversée rapide d’une sélection réduite, suivant le fil rouge de l’écriture justement, tout en assumant aussi l’arbitraire que ce choix implique, dans le travail de six auteurs et autrices marquants : Anh Mat, Jean-Pierre Balpe, Gracia Bejjani, Gwen Denieul, Milène Tournier et Stéphen Urani. Il s’agira d’écriture en tant que geste, « manière spéciale de vivre » (Flaubert 1859) et objet de réflexion, pratique et question existentielle qui s’exprime et s’interroge par le dispositif vidéo ; de la ville comme espace de vie et d’écriture qui inspire et façonne les deux ; et de l’écriture vidéo comme mode de pensée et d’expression qui « déplace l’idée d’écriture » (Dubois 2012, 236). La dernière partie de ce chapitre se penchera ensuite sur d’autres auteurs qui s’intéressent au geste matériel même et qui expérimentent avec des enregistrements de l’écriture en acte.
Nous avons vu que les journaux filmés s’interrogent souvent sur leurs propres motivations et manières de faire, leur capacité à garder une trace du réel et/ou à le transformer en donnant lieu non seulement à des représentations mais également à de nouvelles perceptions et manières de voir le monde et de vivre le quotidien. Une fascination similaire pour l’écriture en tant que pratique, désir, besoin et pulsion relie les diverses vidéo-écritures dont nous allons traiter ici – à tel point que ces écritures deviennent par moments une expression par excellence de ce désir et de son emprise. Entre écriture transitive et intransitive, il s’agit souvent d’une écriture réflexive ou « auto-transitive » dont le sujet, à la fois concret et insaisissable, se cherche, (se) fascine et s’échappe.
Dans son essai sur l’histoire des discours des auteurs sur l’écriture comme pratique (artistique, philosophique, culturelle…), Geneviève Bollème observe que « cet intérêt (pour l’écriture) paraît officiellement avec le journalisme », et notamment avec l’Enquête sur l’évolution littéraire de Jules Huret (1891). Cette enquête fut suivie par toute une série d’autres grandes enquêtes au cours du XXe siècle qui, avec la naissance du genre de l’entretien d’auteur, ont « rapproché » celui-ci des lecteurs (Bollème 1993, 20). « Ce qui est nouveau, note également Bollème, c’est que l’intérêt concerne aujourd’hui l’action d’écrire elle-même, en ce qu’elle a de singulier et d’universel à la fois » (1993, 19). Et les auteurs en parlent en effet de plus en plus – la radio, la télévision, puis Internet avec les blogs, les podcasts et enfin les plateformes vidéo et les réseaux sociaux ont fait exploser la « présence » et l’autocommentaire auctoriaux, sur le geste d’écrire dans toutes ses dimensions. Mais depuis Mallarmé et la modernité en particulier, ils en écrivent aussi, ne se contentent pas d’en parler, et cela sans même qu’on leur pose la question, non seulement dans leurs lettres et journaux, mais dans leurs œuvres même. Les frontières entre la littérature et les réflexions que l’on pourrait appeler théoriques (aussi) se brouillent et de nouvelles avenues s’ouvrent vers la philosophie (qui n’a jamais été très loin). Les philosophes tels que Laporte, Derrida et Deleuze s’emparent également du sujet pour en déceler les ramifications métaphysiques et politiques, sans que ces interrogations cessent d’être personnelles, questionnant leurs propres pratiques d’écriture et les manières d’en parler. D’autre part, ces questions concernent également les praticiens d’autres arts, plastiques et visuels, comme l’illustrent les réflexions de Van Gogh, Klee et Giacometti citées par Geneviève Bollème (1993). Elles jouent aussi un rôle fondamental chez certains cinéastes, notamment chez Godard, qui non seulement investit fortement la littérature et l’écriture dans ses films, mais découvre justement la vidéo comme une manière d’« écrire » du cinéma sans passer par la réduction de l’image à un texte linéaire et purement verbal. Le questionnement sur l’écriture était également présent dans l’art vidéo depuis ses débuts.
Les vidéo-écritures que l’on qualifie ici de littéraires, avec leur médium audiovisuel et leurs contenus et leurs styles personnels, libres de toute attente ou prescription éditoriale, s’inscrivent ainsi dans ces traditions entrecroisées et combinent ces perspectives sur l’écriture tout en mobilisant des langages et des approches variés. Ce « parler d’écrire » n’a donc à la fois rien de nouveau tout en l’étant radicalement dans la mesure où l’écriture sur l’écriture (se) passe ici par un médium qui n’est à l’origine ni textuel ni verbal, mais audiovisuel. De plus, cette écriture se renouvelle en tant que pratique, tout en sauvegardant son « essence » mystérieuse qui hante les auteurs depuis l’émergence de la pensée écriteGeneviève Bollème remonte à Saint-Augustin, mais Derrida nous ramène jusqu’à Platon, qui réfléchit déjà à l’écriture comme pharmakon.↩︎. « La littérature s’écrit aussi en vidéo » : c’est en ces termes que Gwen Denieul présente sa chaîne. Pour nos auteurs et autrices, « filmer, c’est écrire aussi », comme le dit Anh Mat (« errance ») – et vice versa : écrire, c’est désormais filmer aussi. Nous verrons ainsi dans les vidéos d’errances urbaines d’Anh Mat la continuation du questionnement de la relation tourmentée de l’auteur avec l’écriture, entrepris d’abord dans son blog Les nuits échouées, dans lequel les capsules vidéo seront également intégrées ; un flux constant d’écriture déambulatoire qui se surprend et se contemple souvent en acte chez Milène Tournier ; la lutte pour une écriture qui n’a pas de place « dans une société de gestionnaires dociles« Hoel et Léo #2 », Gwen Denieul, 14 octobre 2017.↩︎ » dans les récits et dialogues intérieurs en vidéo de Gwen Denieul ; la série poétique « écrire l’écrire » et nombre d’autres capsules proposant des instantanés de ce qu’est écrire chez Gracia Bejjani ; et des expérimentations audio-visio-textuelles provocatrices chez Jean-Pierre Balpe, qui exploite son logiciel de génération de texte pour construire « Un Monde Incertain », cet ensemble labyrinthique d’œuvres numériques dont les vidéos font désormais partie intégrante. Le sujet occupe aussi Studio Doitsu, dont la capsule « les japonais sont trop forts » met en scène un dialogue de Noémi Lefebvre sur ce qu’est écrire face à une supposée « vie normale » selon une définition « médico-sociale ».
La question de savoir ce qu’est écrire s’enchevêtre à celles de son mobile, de ses auteurs et de son public, de son objet et de ses modalités. Écrire, vivre, marcher, penser, regarder, filmer, monter et mixer des images-sons-paroles-textes se confondent et s’interrogent mutuellement. Ces vidéo-écritures laissent ainsi émerger des sortes d’« (auto)(bio)graphies des graphies », des images poétiques de la vie des écritures.
Écrire vivre
La présentation de la
chaîne de Milène Tournier résume bien l’entrelacement
désormais fondamental entre écriture, vie et vidéo, dont l’esprit sera
partagé par nos autres auteurs et autrices « mordu[·e·s] d’obsession« écrire
l’écrire, inachevé toujours (2) », gracia
bejjani, 22 août 2018.
↩︎ » :
Écrire en/sur/avec la vidéo, c’est venu en voyant le travail de François Bon. Ses longs travelling quotidiens, entre Paris et Cergy, ses vidéos nocturnes de Jean Barbin. Avec un vieux smartphone, et que ça écrivait, ça faisait écrire, ça transformait écrire, mais c’était encore écrire. C’est pas de l’image et de la bande écrite, ce serait plutôt une autre façon d’être dans la journée, dans le temps, et que ça aussi, c’est écrire, c’est déjà écrire. C’est même pas un journal filmé, un journal j’ai jamais su m’y tenir. Creuser la vie-écriture, en osant même le pléonasme, entre ce qu’on voit et ce qu’on lit, -et que deux fois, c’est peut-être pas une fois de trop, c’est qu’on aura encore plus, eu besoin de dire. Que la vie est toujours là, dans la pièce, à l’intérieur de soi, derrière les vitres, dehors. Même pas écrire en vidéo, mais quelque chose comme marcher, regarder, écrire, et sans trop de hiérarchie ni d’avant/après entre les troisVoir la description de la chaîne YouTube de Milène Tournier (la description citée a depuis été réécrite).↩︎.
Une fois la pratique établie, tout peut déclencher l’écriture. Et si ce n’est pas l’écriture qui déclenche la vie, elle devient nécessaire, indispensable même, pour celle-ci.
(Sur)vie et écriture
Chez Milène
Tournier, l’écriture ne se distingue quasiment pas de la pensée
ou même tout simplement d’exister : un monologue intérieur d’un élan
qui semble irrésistible et qui se verse directement dans des textes,
désormais en vidéo avec les images des objets et des espaces qui les
ont fait surgir. « J’écris continûment, ce n’est pas écrire alors ? »,
se pose-t-elle la question« Journal
ouvert J’écris près d’un grand abandon bientôt », Milene
Tournier, 2 janvier 2019.
↩︎. La vidéo est
désormais une forme privilégiée de cette manière d’être et de
« creuser » constamment par l’écriture. « [J]e filme parce que je
saurais pas décrire », précise-t-elle aussi« Envie à la
fois de vivre et de pouvoir mourir », Milene
Tournier, 4 décembre 2019.
↩︎,
soulignant l’importance de l’image et sa relation de complémentarité
avec le texte.

La pratique du langage par la vidéo permet ainsi de se concentrer davantage sur l’invisible dans ce travail qui consiste à « débusquer la poésie du quotidien, la vitalité du banal » (2020), motivation qui nous rappelle celle des journaux filmés. Se trouver incapable de tenir un journal n’empêchera d’ailleurs pas l’autrice d’utiliser cette étiquette dans le titre de plusieurs séries : « Journal ouvert », « Journal du Sud, filmer revenir » et « Journal de Compostelle, filmer ne pas partir ». Ni la forme ni le fond n’y sont pour autant fondamentalement différents des capsules rangées dans les autres séries, et les playlists « Alice dans les villes », « Quarantaines », « Jours Quarantaines / Confinement » et « Jours déconfinés » pourraient également être considérées comme des pages de journal. Le seul trait qui les distingue des journaux filmés dont nous avons traité dans le chapitre précédent, c’est que ces écrits ne sont pas datés à l’intérieur des capsules mêmeL’interface YouTube montre par défaut la date de publication de capsule en paratexte, mais les journaux vidéo (ou journaux filmés) présentés dans le chapitre précédent et qui se définissent en tant que tel indiquent toujours la date dans la capsule même.↩︎. Or ce détail est loin d’être anodin : il marque au contraire une approche différente de l’écriture et du réel ainsi que de leur relation. Seul importe ici le fait que ces perceptions, ces moments, ces idées et ces mots ont eu lieu, et que la capsule les conserve. Le moment et le lieu exacts n’ont pas d’importance, ils ne sont souvent même pas identifiables. L’essentiel est qu’il y a eu frottement entre le moi et le monde qui a fait jaillir des mots, des phrases, des textes. Ce temps intemporel, métaphysique plutôt qu’historique, et cet espace dont comptent davantage la nature et les pensées qu’il suscite que le nom ou la localisation factuelle, caractérisent aussi le travail des autres auteurs évoqués iciAu début, Gracia Bejjani numérotait et datait les capsules de son « micro journal » (ensuite renommé « microjournal ») dans le titre indiqué sous la fenêtre de visionnage, mais sans les inclure dans le montage même. Le fait que les images reviennent parfois d’une capsule à l’autre montre également qu’il ne s’agit souvent pas de prises de vue du même jour. Les dates apparaissent cependant en fin de capsule dans la série « même jour d’avant », entamée pendant le confinement de 2020 et incluse dans le « micro journal ». Le dernier plan porte ici l’inscription de la date de la prise de vue et de celle de l’écriture, séparées exactement d’une ou de plusieurs années. Cet écart temporel nous éloigne également du journal, même si celui-ci reste un genre très ouvert.↩︎.
Anh Mat
– qui déjà dans son blog rendait invisible la date des billets –
souligne que « creuser la vie-écriture » signifie aussi creuser le
chemin vers l’Autre : « Je filme comme on creuse un tunnel entre moi
et vous« la marche des
mots », Anh Mat, 10
juin 2019.
↩︎ ». Gracia Bejjani, dans sa
série « écrire
l’écrire », pousse l’importance de ce « tunnel » encore plus
loin : « à ne plus distinguer écrire d’aimer / aimer, écrire« écrire
l’écrire, l’aimer (5) », gracia
bejjani, 12 septembre 2018.
↩︎ ». L’écriture elle-même devient
cependant aussi un « autre » qui à la fois exige la solitude et en
sauve. Ainsi dans l’expérience d’Anh
Mat :
J’écris pour ne pas rester seul avec mon corps. Mon corps trop faible pour dominer seul l’angoisse. Il y a quelques années je dérivais tranquillement dans les heures en faisant la planche. Aujourd’hui écrire est une bouée pour ne pas me noyer en moi-même. La feuille blanche rassure. Toujours quelque-chose apparaît en son sein. Sans écriture, il ne se passe rien. Sans écriture le corps, la pensée, les nerfs… fatiguent de vivre en silence (2017a).
Toute une dimension existentielle se déploie ainsi qui concerne non
seulement la présence dans le monde que l’écriture peut enrichir,
rendre supportable, ou même sublimer et transcender sans le nier, mais
aussi l’être en soi et avec soi du sujet scripteur – dont la nature
sera toutefois aussi remise en question – en tant que corps et pensée,
aussi bien que l’être-avec l’Autre, pourtant absent. Il ne s’agit donc
de rien de moins que de « vivre d’écriture », comme le dit Gracia Bejjani dans son « autofictiographie (3) »,
d’autant plus que « le réel est une phrase« empreintes
d’accent, une phrase aujourd’hui - même jour d’avant (6) | gracia
bejjani », gracia
bejjani, 12 avril 2020.
↩︎ ». Cette phrase, quelque
fragmentée ou infinie qu’elle soit, et par conséquent le réel qu’elle
constitue, n’existe que dans et par l’écriture et uniquement dans la
mesure où on l’écrit.

Or, « [é]crire, c’est creuser des trous dans la brume. Du fond de
ton terrier, laisse-toi surprendre par les apparitions. Le réel est ce
à quoi on ne s’attend pas », précise Gwen
Denieul« Écriture
#1 | réapprendre à parler », Gwen
Denieul, 9 mars 2018.
↩︎. L’acte d’écrire est ce curieux
mélange d’effort et d’attente qui fait émerger l’inattendu, le réel
au-delà de la face évidente des choses. « Chercher ce qui fait
présence », répond aussi le vidéopoème de Stéphen
Urani à la question posée dans le titre : « Qu’est-ce que tu
cherches ? ». Chez Milène
Tournier, cette quête dont on ne connaît pas l’objet rend
inepte la question qu’il est, selon son père, nécessaire de se poser
– à savoir « ce que tu veux raconter » – face à « l’absurdité d’avec
ma vie, pendant ma vie, écrire comme ça » - un geste dont l’ultime
raison d’être est le « besoin d’écrire« Un bisou
qu’on laisse sur un front Journal ouvert », Milene
Tournier, 27 décembre 2018.
↩︎ ».
N’avoir d’existence ou une existence authentique que par l’écriture
vaut aussi pour le sujet scripteur – une expérience que Gwen
Denieul attribue à Léo, son personnage et alter-ego : « Je
ne suis moi que lorsque j’écris, se répète-t-il pour se donner la
rage suffisante, le reste du temps, je mens. L’écriture est une
stratégie de survie« Écriture #1
| réapprendre à parler », 9 mars 2018.
Italique dans le texte original publié sur le site Les Cosaques des
Frontières (2018).↩︎ » La question ne
semble même pas se poser chez Milène
Tournier, qui pendant une période publiait parfois plusieurs
capsules par jour, ou chez Anh Mat,
pour qui par moments « rien n’arrête la marche démente » de
l’écriture« la marche
des mots », Anh Mat, 10
juin 2019.↩︎ – et lorsqu’elle s’arrête, c’est
le vide ou même la souffrance –, ou encore chez Gracia Bejjani :

Cette écriture est pourtant loin d’être facile ou simplement
heureuse : « Je ne peux écrire qu’en vivant au bord du
gouffre », précise encore Léo chez Denieul« Hoel et Léo
#2 | entrer en résistance », Gwen
Denieul, 14 octobre 2017. Italique dans l’original.
↩︎. Ce gouffre est en même temps
l’écriture même, en un rapport « inconfortable… et addictif » selon
Anh
Mat également (2017e), qui se sent « esclave d’une
écriture qui [l]e dépasse » (2017h). Citant Marguerite
Duras, il compare l’écriture à une maladie incurable :
L’écriture me détruit physiquement. Je mourrai d’écriture comme on meurt d’un cancer. […] Tout devient écriture. Je me sens emmuré dans chaque phrase. Il n’y a plus que le présent de l’écrire. J’en suis le prisonnier, le rat de laboratoire, le territoire à coloniser (2017d).
Malgré la production intense, ce rapport n’est pas non plus si
léger chez Milène
Tournier, qui admet : « j’écris à cause du désespoir« Journal
ouvert J’écris près d’un grand abandon bientôt », Milene
Tournier, 2 janvier 2019.↩︎ », ni pour Gracia Bejjani, qui parle
de « combat« écrire
l’écrire, combat (6) », gracia
bejjani, 28 octobre 2018.
↩︎ » et d’« écrire pour épuiser
vivre / et s’y épuiser« écrire
l’écrire, ressac (8) », gracia
bejjani, 3 février 2019.
↩︎ ». Puisque c’est
cette même écriture qui permet de « ne pas désespérer tout à fait« Écriture #3
| une solitude tenace », Gwen
Denieul, 5 mai 2018.
↩︎ ».
Tout en étant la seule échappatoire – « [à] chaque phrase écrite,
j’échappe à ma condition de salarié », dit Denieul
dans « Sauver sa peau » –,
le pouvoir de l’écriture rend le scripteur impuissant aussi face à
elle. La capsule 38 du « micro journal » de Gracia Bejjani résume
magistralement toute l’ambiguïté de l’écriture-pharmakon : face à la
folie du monde et le passé qui hante, « je ne fais pas, j’écris //
m’use d’impuissance », écrit et dit-elle« j’assiste à
l’époque | gracia bejjani », gracia
bejjani, 8 mars 2020.
↩︎. L’homophonie de « m’use » se
conjugue avec l’absence de sujet grammatical dans la dernière
proposition et laisse la phrase ouverte à plusieurs interprétations :
je m’use d’impuissance en écrivant, je reste impuissante dans
l’écriture, ou l’écriture reste impuissante ; l’écriture m’use
d’impuissance, elle m’épuise tout en me rappelant mon impuissance (de
faire, d’écrire, ou malgré le fait d’écrire ?) ; ne pas faire m’use
d’impuissance, (donc) j’écris ; j’écris comme une muse d’impuissance ;
j’écris, l’impuissance (de faire ?) est ma muse ; j’écris, mais la
muse est aussi impuissante… Cette syntaxe elliptique au riche
potentiel sémantique s’inscrit sur un fond d’enchaînement fragmenté de
plans en noir et blanc qui parcourent une peinture murale chargée de
figures humaines, puis laissent défiler le graffiti « SAVE OUR EARTH »
lorsque le texte arrive à « m’use d’impuissance ».

L’image fournit ainsi non seulement une toile de fond visuelle intensifiant la charge atmosphérique, mais ajoute également une couche au texte, en précisant et en élargissant à la fois le champ sémantique.
Les espaces filmés et les agissements de la caméra avec l’autrice-filmeuse spectrale qui évolue et écrit avec son corps dans et avec ces espaces mêmes ont en effet un rapport direct à cette écriture qu’ils font surgir et dont ils deviennent parties constitutives. Mais qui est d’abord ce « je » issu de ce corps qui parle par la voix de ces spectres ? Et où, ou qui, serait la source et l’épicentre de cette écriture ?
« Je » et ses autres
« (E)st-ce encore moi », se demandent, sans point d’interrogation,
le texte écrit et la voix démultipliée en échos de Gracia Bejjani, enfermés
dans l’instant présent et confinés dans l’espace, face à des
« identités martelées« j’assiste à
l’époque encagée | gracia bejjani », gracia
bejjani, 20 mars 2020.
↩︎ ». « Derrière l’objectif, je
reste un pronom qui écrit, personnage errant dans un lieu
d’écriture », dit Anh Mat, ou
ce « je » qui se manifeste par sa voix« Đà Lạt,
filmer des phrases (2) », Anh Mat, 3
mars 2020.↩︎.
Milène Tournier, quant à elle, affirme dans le titre d’une capsule : « Je est un éclatement du vide » – un « je » que l’écriture semble cependant sauver de quelque manière, et qui participe du « spectacle » que l’écriture permet de (re)constituer.

« Spectacle! » par Milene Tournier
Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.
Crédits : Milene Tournier
Dans sa série proliférante « Je t’aime comme… », cet enchaînement surabondant de comparaisons entre cet amour, dont on ne connaît ni l’objet ni vraiment le sujet, et des choses et des phénomènes des plus abstraits aux plus banals et fantaisistes, la signification de « je », « te » et « aimer » à la fois se concrétise, s’enrichit et se brouille avec chaque nouvelle comparaison. L’amour qui se manifeste, c’est surtout celui pour l’écriture qui concerne tout, par un sujet qui ne vit que dans et par cet amour :

Cette expérience du sujet vid(é)e de sens que seule l’écriture peut sauver ou doter d’une existence et dont l’écriture a en même temps besoin pour « s’y loger » est encore plus marquée chez Anh Mat :
Toujours mal à l’aise avec cette tenace impression de n’être personne, de n’exister que de mots, que le reste n’existe pas quand j’écris. Ce n’est pas là une posture. Mais un constat. Je ne suis pas ce que j’écris (2017g).
Une vidéo reprenant un billet précédent précise encore :
Il m’aura fallu plus de quatre ans pour oser prendre la parole en tant que personne. Pour parler en mon nom, en mon corps, il a fallu d’abord chercher où j’étais. Trouver un soi où loger sa parole passe par quelques métamorphoses. Combien de visages, de personnages ai-je incarnés ? En ce moment même, je prétends écrire en mon nom, mais avec la sensation tenace de ne pouvoir entièrement échapper à la fiction. Chaque vidéo est une énième tentative d’identité sous laquelle oser s’adresser à l’autre« la marche des mots » (Anh Mat, 10 juin 2019) et Les nuits échouées (2017f).↩︎.
Quelqu’un écrit et parle de soi, mais l’écriture ne parle pas de lui, elle n’est pas lui – et pourtant il n’existe que par elle et elle par lui. Il n’(y) a pas d’existence hors l’écriture, mais la nature de l’existence que l’écriture procure et de l’identité qu’elle permet de créer ou manifester reste opaque et incertaine.
Les pistes se brouillent aussi chez Gwen Denieul, dont les récits polyphoniques attribuent des expériences et des pensées à des personnages – Simon, Samuel, Léo, Hoel – mais d’une manière flottante, en gardant toujours une place pour l’incertitude quant à leur nature et appartenance :
Toujours il m’a fallu inventer pour comprendre ce que je vis. Alors je rêve d’un long récit tissé de la vie des autres, d’une fiction m’approchant du réel, creusant le réel, d’un grand roman comme expérience directe de la vie. Avec les miettes de moi et des autres j’inventerai d’autres existences, sèmerai d’autres graines. Ce sera comme jardiner sous la lune« Écriture #2 | les morceaux d’inconnu que tu portes en toi », Gwen Denieul, 6 avril 2018.
↩︎.
Ce passage à la première personne fait partie d’un texte qui oscille entre « je », « tu » et « il » pour présenter cette expérience, sans que le référent de chaque pronom personnel soit clair, et où figure un certain « Léo ». Figure d’écriture, sans doute, mais aussi « double fantomatique » de l’auteur, tout comme ce « je », encore flottant entre Léo et une voix d’une source incertaine, le précise à propos de Hoel dans la capsule intitulée « Hoel et Léo #1 | comme si quelqu’un d’autre parlait en moi », pendant que l’on voit l’auteur qui lit ce texte, un bâtiment vide sous les falaises au bord de la mer, puis un autre, délabré :
Je l’appelle Hoel car il est mon reflet frénétique, mon double inversé. Je l’appelle aussi comme ça pour la sonorité : Ho-el, avec à la fin cette voyelle ouverte sur le monde. Ho-el, l’eau et les ailes. (…) Il est celui qui, en moi, est plus grand que moi. Un être plus intense, plus secret, plus farouchement exilé. Sans doute aussi plus lucide et plus profond que moi. Au dehors rien n’y paraît, mais avec Hoel on s’entredéchire sans cesse. […] J’ai besoin de ce double fantomatique pour penser contre moi-même, besoin d’un adversaire aussi tenace que lui à surmonter. La désaliénation passe par là, me dis-je. Son esprit critique m’enrichit jour après jourAnh Mat se fait aussi personnage de son côté, dans « l’autre je » (23 février 2017), où l’on voit une mise en scène de l’auteur qui se lave les mains et parle un peu. Peu avant, il avait noté dans le billet #502 de son blog : « “Je” est ici pronom impersonnel mais pas sans personnalité. Il est doté d’intimité, oui l’intimité anonyme d’une silhouette penchée sur son écran, travaillant l’écriture en silence, sans fierté ni humilité » (2017b).↩︎.
Fiction nécessaire donc, dont on ne connaît pas les frontières mais qui donne accès au réel et permet de (mieux) le vivre – avec son inévitable part de fiction. Cette incertitude ontologique du sujet est aussi la base de la série « autofictiographie » de Gracia Bejjani, où la présence (grammaticale) du « je » est tellement marquée que l’on pourrait prendre ces capsules pour ses confessions directes – s’il n’y avait pas encore ce « -fictio- » qui s’incruste dans le titre entre soi (« auto ») et l’écriture (« graphie ») pour déstabiliser cette interprétation tout en l’invitant. Nous avons vu que cette problématique est également présente dans les journaux vidéo, qui assument leur continuité avec les fictions, notamment chez Michel Brosseau et François Bon (cf. chapitre 5).
Si le dispositif vidéo tel qu’il est investi par ces auteurs et autrices rend impossible que leur présence disparaisse entièrement, puisque c’est leur main qui tient la caméra la plupart du temps, tout comme pour les journaux filmés, il l’efface aussi dans la mesure où il impose un choix entre tourner la caméra vers le monde ou vers soi-même. Entre les deux reste cette présence spectrale, indirecte, par le corps derrière la caméra ou par son ombre ou reflet projeté dans l’espace filmé, propice à cette déstabilisation ontologique et épistémologique qui favorise en même temps la poéticité des écritures.
Le travail de Jean-Pierre Balpe fait exception en poussant la disparition du sujet et toute subjectivité jusqu’à son extrême. Si son ombre, son reflet et sa voix apparaissent dans quelques capsulesVoir par exemple son « Dada (Saison 1, Épisode 5) » (28 mars 2016) pour l’ombre.↩︎, le recyclage d’archives audiovisuelles et la création numérique d’images synthétiques dominent largement dans sa création vidéo, attribuée à des « auteurs » virtuels, dont les textes proviennent d’un générateur automatique de textes. Balpe affirme toutefois être « le maître du jeu » (2016), initiateur du « monde incertain » qui constitue son œuvre et incarne sa vision de la littérature (numérique). C’est lui qui choisit les sujets, les « auteurs », les images, les sons et les voix, et c’est lui qui les mixe, monte et publie. La déconstruction se mord ainsi la queue et se déconstruit elle-même par la présence spectrale mais aussi très concrète et indispensable de l’auteur derrière son ordinateur et ses avatars aux noms proustiens. Ironie à double tranchant qui se moque de la figure classique de l’auteur dont la subjectivité régnait sur son écriture, mais qui se retourne du même geste contre le moqueur qui se suggère en quelque sorte supérieur car prêt à disparaitre – et qui se réaffirme dans et par sa disparition ainsi assumée… Ironie et paradoxe que l’auteur assume entièrement.
En somme, la fiction et ses frontières brouillées avec le réel semblent essentielles dans ces vidéo-écritures. L’accès à soi et au monde est inséparable de leur invention par l’écriture – et vice versa. Comme le dit Anh Mat, « toute fiction, aussi fantastique soit-elle, est entretien avec le réel« la marche des mots », Anh Mat, 10 juin 2019.↩︎ », et qui admet :
Ce que je filme, est-ce ce que je vois ? Ce que je filme vient aussi de ma tête, de mon imaginaire, des textes préécrits en moi« Đà Lạt, filmer des phrases (2) », Anh Mat, 3 mars 2020.↩︎.
Ou encore plus radicalement, Stéphen Urani, qui se demande « où se tient le réel ? » et se répond : « Nul réel hors tes fictions« Nul réel hors tes fictions », Stéphen Urani, 25 novembre 2018 (cette vidéo a été supprimée par l’auteur).↩︎ ». Mais nulle fiction non plus qui ne soit (inspirée par) le réel.

Urani, qui présente sa chaîne comme un « [r]ecueil de vidéos-poèmes autour de l’expérience citadine », souligne par ailleurs que le statut incertain du sujet de la vidéo-écriture – dans les deux sens du « sujet » – est en rapport direct avec l’esprit de ce nouveau mode d’écriture que constitue la vidéo-écriture et avec la ville qui en représente l’espace principal :
Ce n’est plus d’expérience intérieure qu’il s’agit dans cette écriture filmée, plus question de donner uniquement à lire ce que la ville nous fait, à grand coup d’émotions ou de concepts. Il nous semble que se dégage de nombre de tentatives sur Youtube la volonté de donner à voir quelque chose qui n’est pas soi seulement, une ville qui n’est pas seulement le miroir de nos états d’âmes. Il s’agit souvent d’en montrer des parts négligées ou des points d’intensités, de dire pour pointer et cadrer littérairement dans le cadrage de l’image. Il s’agit de donner au visible une fonction de désubjectivation partielle de la parole, de faire de celle-ci un morceau de l’image, de la même manière que l’image acquiert un statut littéraire (2019).
Écrire ville
La ville et la littérature, c’est une vieille histoire d’amour, qu’il s’agisse de poésie, depuis Baudelaire jusqu’à Jacques Roubaud, de prose, de Balzac au « roman urbain » contemporain (Stierle 2001 ; Horvath 2017), ou de journal vidéo, comme on l’a vu dans le chapitre précédent, avec François Bon ou Pierre MénardLa pertinence du sujet à travers les formes et les champs est confirmé par l’association Écrire la ville, qui discerne un prix annuel sans limitation de genre ou de domaine et qui se veut à « la croisée entre un prix littéraire et un prix portant sur l’urbanisme, l’architecture, les sciences sociales » (2019).↩︎. Paris en particulier fascine les auteurs depuis deux siècles et incarne « à la fois le monde et le livre » (Stierle 2001, 3). Mais de manière plus générale, la ville représente « un inépuisable générateur de signes » (2001, 24) où les auteurs peuvent « lire ce qui n’est pas écrit », comme dit la formule de Hofmansthal appropriée par Benjamin (2001, 5), et écrire ce qu’ils lisent. À chacun et à chacune dès lors d’inventer ses manières de « prélever dans les signes que le paysage urbain propose des assemblages et des circonstances propices à la composition de poésie », comme le dit Jacques RoubaudPoésie (2000, 14), cité par Christophe Reig (2008, 32).↩︎.
Errance
Si la ville est ainsi, selon la formule d’Anh Mat, « une école à travailler la langue », et qu’il suffit de « ne faire que regarder la ville, et écrire » (2017d), le regard comme l’écriture se mettent en branle par la déambulation. Le flâneur reste, comme le constate Karlheinz Stierle, « la figure par excellence du philosophe de la ville » (2001, 25), mais un philosophe que la marche lie dans une « “relation affective” à la villeDavid Le Breton cité par Rachel Thomas (2007, 19).↩︎ ». La vidéo, quant à elle, non seulement matérialise l’« activité visuelle continue » (2007, 19) qui caractérise la flânerie, mais permet d’écrire « à même la peau » des villesC’est le titre d’une capsule d’Anh Mat : « à même la peau de Saigon » (21 août 2018).↩︎, en posant les mots et la voix que la ville inspire directement sur les images prises lors des déambulations. Pour Anh Mat comme pour Milène Tournier, dont on a vu le désir de « marcher, regarder, écrire, et sans trop de hiérarchie ni d’avant/après entre les trois », « [m]archer va avec écrireMilène Tournier, descriptif de « Spectacle! » (6 mars 2020).↩︎ » et les mouvements participent directement de la création : « Les trajets sont importants, ils font partie du flux de l’écriture« la marche des mots », Anh Mat, 10 juin 2019.↩︎. »
La mise en mouvement du corps non seulement lance l’écriture en
tant que processus, mais anime aussi le texte produit, qui évolue de
fil en aiguille, à l’instar de la marche errante par laquelle on
accompagne l’auteur : « je ne sais jamais où je vais, c’est l’errance
qui me guide. Écrire, c’est errer », dit Anh Mat« errance », Anh Mat, 4
septembre 2016.
↩︎. Tout comme la marche et
l’enchaînement des plans dans le montage final, la parole s’interrompt
par moments (mais pas forcément aux raccords) et laisse les images et
les bruits de la ville continuer l’écriture en nous,
lecteurs-spectateurs de vidéo.
La diction calme et incantatoire de la voix suave d’Anh Mat, parfois accompagnée d’une musique de fond instrumentale, produit un effet mélancolique de flânerie existentielle au milieu du bruit de la vie urbaine. Traverser la ville veut dire se laisser traverser par elle : écouter et « donner la parole à la ville uniquement« la marche des mots », Anh Mat, 10 juin 2019.↩︎ ». Il s’agit donc de la voix de la ville à travers et au-dedans de soi : les errances ont lieu dans l’espace mental qui se superpose et se confond avec l’espace physique et social de la villeRachel Thomas rappelle la prédilection de nombre de philosophes pour la marche, qui met « simultanément en jeu le corps du piéton (ou plus précisément la manière dont ce corps mouvant nourrit sa relation avec le monde) et son esprit, l’exercice de la marche et son rythme favorisant ceux de la pensée. » (Thomas 2007, 18).↩︎. Comme le dit Caroline Rosenthal, « cities are made of dreams, imaginations, and representations as much as they are made of concrete streets, buildings, and people« les villes sont autant faites de rêves, d’imagination et de représentations que de rues, de bâtiments et de gens » (notre traduction).↩︎ » (Rosenthal 2011, 1). La ville qui s’écrit par la voix de l’auteur devient ainsi à son tour source et réceptacle de ses réflexions, émotions, mémoires et fictions, de ce « bruit de fond intérieur » : « un regard sur la ville est un regard sur soi« Đà Lạt, filmer des phrases (2) », Anh Mat, 3 mars 2020.↩︎. » Ce « soi », présence spectrale, intègre la rue tout en lui restant étranger, avec l’appareil enregistreur qui non seulement introduit un filtre, une distance et une absence autre dans l’espace de vie des autres, mais change aussi la posture, le rythme, la perception et la manière d’être et d’évoluer dans l’espace de celui qui le tient.
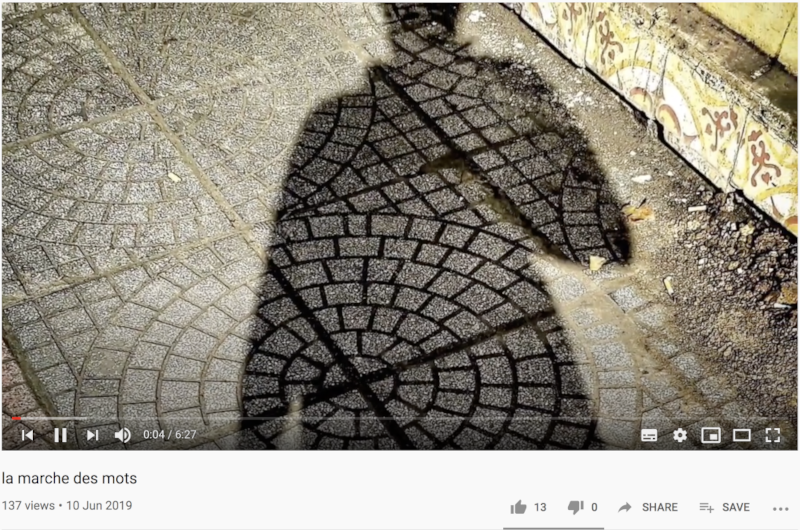
Parce que tenir la caméra, pour Anh Mat, c’est toujours déjà écrire :
La ville se confie à ceux qui prennent le temps de la regarder de l’écouter en silence quotidiennement sans opportunisme. La ville et la fiction qu’elle porte à son insu, fiction qui donne un sens à l’errance, à l’ennui. Je ne filme pas le réel, je filme les phrases dans lesquelles je déambule. L’objectif guette le moindre mot et saisit non des images, mais des notes, des vibrations d’instants intérieurs au cœur d’absences prolongées ou plus rien ne passe, si ce n’est l’écriture, son flux, l’écriture nue, sans but, une parole errante qui circule entre les murs d’une ruelle minuscule. […] Depuis toujours l’écriture rature les traits de mon visage, trouble les lettres de mon nom« Đà Lạt, filmer des phrases (2) », Anh Mat, 3 mars 2020.↩︎.
Imprévu
Si Anh Mat
absorbe la ville en s’absorbant en elle tout en lui restant étranger
et laisse la parole prendre forme de ce curieux mélange, les errances
de Milène
Tournier, véritable « spectateur du théâtre de la rue » (Thomas 2007,
16), sont de petits voyages dans le pays des merveilles
urbaines quotidiennes, comme le titre de sa liste « Alice
dans les villes » le suggère. Cette « sorte de méditation
marchée« IDOLES
D’ICI », Milene
Tournier, 21 novembre 2019.
↩︎ » fait feu de tout bois, et
l’étincelle est ici aussi fournie par le frottement entre la ville et
le regard de l’autrice, avec ses souvenirs, ses questionnements et son
imaginaire. « Jouer avec la ville, à regarder », écrit-elle dans le
descriptif des capsules de cette série : « S’émerveiller d’abord, ça
fera venir les merveilles ». « Spectacle! » dévoile aussi
le processus que l’on y voit se réaliser : « on ira voir se tramer les
histoires ». Le « spectacle » est toujours partout en train de se
faire, il suffit de déambuler pour en recueillir les morceaux, de
regarder attentivement à travers le filtre des mots et de le laisser
se tisser.

Toujours comme le flâneur donc, « avide de capter, de sonder, de rapporter et de coordonner les mesures, son regard curieux ne se lasse pas des spectacles que lui donne la métropole » (Horvath 2017, ch. 5). Et toujours, la caméra du smartphone permet d’enregistrer la trace visuelle et sonore des objets, des micro-événements et des situations qui déclenchent des métaphores, des associations d’idées, des histoires, que d’autres visions vont permettre de poursuivre en les amenant dans des directions imprévues, dictées par le hasard des rencontres et des découvertes. Ainsi l’image d’une petite flaque d’eau réfléchissante avec sa surface frémissante sous la pluie qui tombe rappelle les grands « remous d’époque » autour, dont elle devient l’emblème :

Plus tard dans la même capsule, on voit un quai de la gare SNCF de la ville de Sens avec deux jeunes qui entrent au ralenti et s’assoient sur un banc, plan fixe frontal entrecoupé brièvement par l’image de la salle de spectacle vide qui ouvrait la capsule, cette fois avec le texte en majuscule « SPECTACLE MAINTENANT ! ». Suit un petit bout d’arc-en-ciel embrassant la Bibliothèque nationale de France à Paris, avant de passer à l’image d’une route vide qui traverse des champs pour se perdre à l’horizon, et la question écrit au-dessus : « SENS ? ». Un mouvement de caméra à 360 degrés nous montre les champs et la route dans l’autre direction avant de retrouver le cadre initial, et la réplique inscrite sur le ciel gris pendant ce mouvement : « déplacer le SENS ».
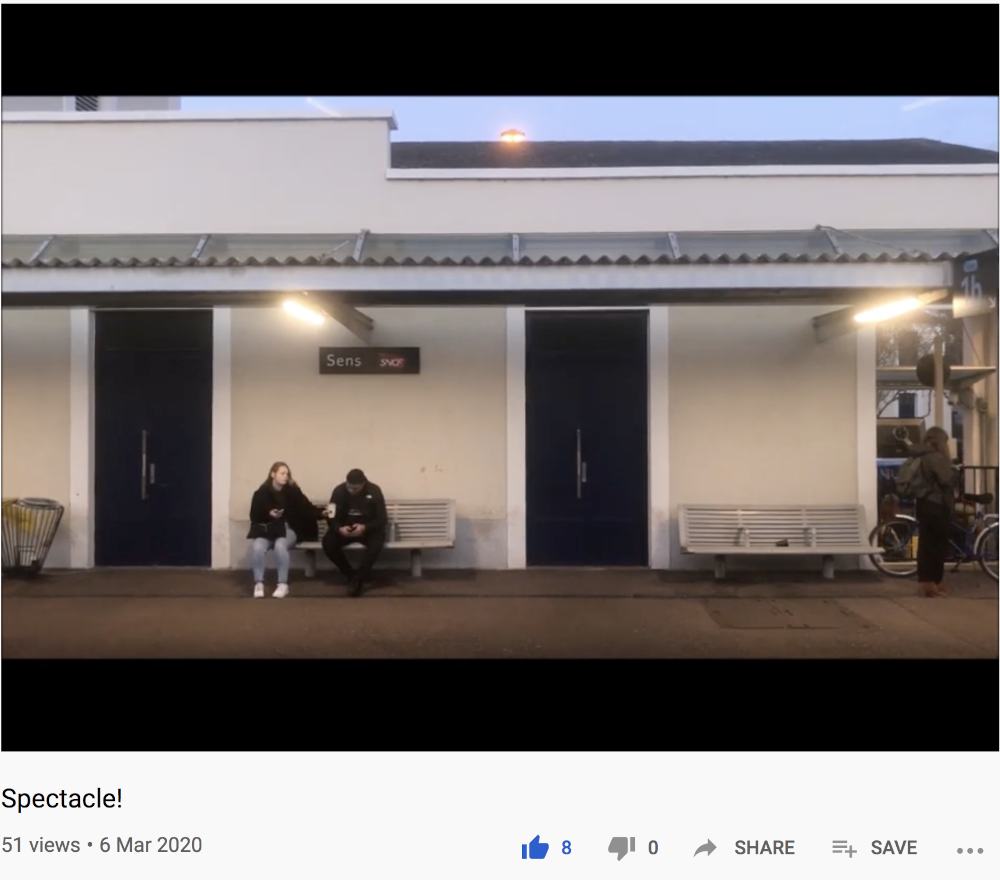

Cette séquence résume bien l’un des mécanismes principaux de ces « méditations marchées » : le sens d’un objet, d’un espace, d’un texte banal trouvé dans l’espace public se révèle ambigu, riche d’une autre couche. L’écriture lui donne un nouveau sens ainsi qu’une nouvelle vie en le détournant puis en le remettant dans une perspective différente, souvent plus large et plus abstraite, et en bâtit des bouts de spectacle et de fiction poético-philosophiques.
Si ce « Spectacle! » paraît particulièrement orchestré, avec des images prises lors de différentes sorties et voyages, probablement sans que l’idée de cette composition guide les prises de vue, en d’autres occasions c’est vraiment le hasard d’une seule promenade en ville qui semble fournir des éléments au bricolage poético-narratifVoir par exemple « Avant de sortir de quarantaine, j’ai dû répondre aux questions du sphinx », qui construit une allégorie élaborée de l’écriture à partir d’une statuette de sphinx aperçue dans une vitrine de magasin et d’autres éléments trouvés dans la rue qui font rebondir l’histoire. La figure du sphinx rappelle par ailleurs les réflexions d’Aragon dans Le Paysan de Paris : « nos cités sont ainsi peuplées de sphinx méconnus qui n’arrêtent pas le passant rêveur, s’il ne tourne vers eux sa distraction méditative, qui ne lui posent pas de questions mortelles. Mais s’il sait les deviner, ce sage, alors, que lui les interroge, ce sont encore ses propres abîmes que grâce à ces monstres sans figure il va de nouveau sonder. » (1926, 18).↩︎. À partir de ces petits riens de récup urbaine visuelle, les capsules parlent ainsi d’un peu de tout entre la vie et la mort dans toute leur complexité, mais sans aucun didactisme, toujours sur un ton d’émerveillement entre contemplation, invention et réflexion. Tout comme Philippe Dubois constate à propos des Nyst :
Tout l’art du conteur consiste à ne rien perdre de tous ces moments d’émerveillement, à ne rien refuser de toutes ces rencontres poétiques, tout en réussissant à les faire tenir ensemble comme en un récit continu, fût-il fait de croisements et de zigzags (2012, 197).
De manière moins systématique, nous retrouvons ce procédé poétique, en particulier l’inspiration par les objets trouvés, les spectacles du quotidien, le déplacement et l’élargissement du sens, chez nos autres auteurs et autrices, avec des déclinaisons qui leur sont propres. Ainsi Gracia Bejjani exploite-t-elle souvent le hasard en prenant son temps dans le moment, contemplative, et en tirant sur les fils du réel visible pour aller plus loin dans le monde, dans le langage et en elle-même. Les deux minutes du numéro 28 du « micro journal » (désormais renommé « tendresse de béton »), par exemple, s’attardent sur deux images de feuilles mortes, une aplatie sur les dalles humides, que l’on voit pendant une vingtaine de secondes, et l’autre dans une flaque d’eau, qui occupe le reste de la capsule, pendant que l’on entend le bruit ralenti et aggravé de voitures qui passent :


« tendresse de béton | gracia bejjani » par Gracia Bejjani
Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.
Crédits : Gracia Bejjani
Les feuilles, points d’accroche dans le réel, inspirent une série de propositions poétiques à la première personne du conditionnel – des intentions ou des promesses hypothétiques, ou des désirs réels ou imaginaires : « je serais lenteur // dans la tendresse du béton », et lorsque le reflet d’un oiseau passe devant celui des nuages dans la flaque d’eau : « je serais ton envol pluvieux // dans le grand voyage des nuages ». Chacune des deux images se démultiplie en une série de plans avec de légères modifications d’angle et de distance, de petits mouvements de caméra avec des raccords et transitions qui ne se cachent pas. Le tout donne ainsi une impression de flottement et de fragmentation, comme une série de départs qui constituent en même temps un enchaînement, tout comme le texte lui-même. L’imprévu ici, c’est la rencontre avec deux feuilles mortes dans la rue, la rencontre des deux feuilles mortes sur la table de montage numérique, leur rencontre avec l’écriture, et les mots et le(s) moi qui en émergent, à la fois précis et fugaces parce qu’en devenir sans dénouement.
Dans les récits (semi-)fictionnels d’inspiration manifestement autobiographique de Gwen Denieul« Toujours il m’a fallu inventer pour comprendre ce que je vis. Alors je rêve d’un long récit tissé de la vie des autres, d’une fiction m’approchant du réel, creusant le réel, d’un grand roman comme expérience directe de la vie. Avec les miettes de moi et des autres j’inventerai d’autres existences, sèmerait d’autres graines. Ce sera comme jardiner sous la lune », écrit-il dans « Écriture #2 », dans une première personne qui reste ambiguë entre la voix de l’auteur, un narrateur sans nom, et Léo.↩︎, l’écriture prend encore plus explicitement le rôle de la recherche de l’imprévu lorsque la vie établie dans la « société de gestionnaires dociles » ne lui laisse plus aucune place : « Une certaine désinvolture est nécessaire. Je dois miser sur la chance, aller d’imprévu en imprévu, de croisements en bifurcations, à tout prix éviter la lourdeur. Ça y est, la main trace les premières lettres sur le papier. Écrire comme on peint, écrire comme on joue« Écriture #1 | réapprendre à parler », italique dans le texte publié sur Les cosaques des frontières (2018). Dans son blog, Denieul raconte sa rencontre avec le peintre belge France Gentil lors d’un voyage au Mali en 2001, qui lui parle de la peinture comme d’une manière d’apprendre à mieux voir le monde qui exige une recherche et un apprentissage constants. Cela vaudrait donc pour l’écriture aussi (et tout art figuratif sans doute), même si ici il s’agit plutôt de suivre la chance, l’intuition (2019).↩︎. » Le point de départ serait ici aussi la ville et la vie de tous les jours dedans :
Retrouver l’intensité laissée en friche. Tu veux écrire quelque chose de vital, le minimum du minimum. Raconter avec les mots les plus simples l’ordinaire : la vie dans la rue, dans le métro, dans les gares, aux terrasses des cafés, dans les bureaux vitrés, dans les chambres louées à la nuit, sur les écrans. Dire aussi la mort tout près, et la joie d’être encore en vie, et l’urgence de vivre« Écriture #1 | réapprendre à parler », Gwen Denieul, 9 mars 2018.
↩︎.
Or, si « [l]’inouï peut surgir de deux mots qu’on met ensemble« Écriture #1 | réapprendre à parler », Gwen Denieul, 9 mars 2018.↩︎ », il faut « [t]rouver les mots qui ravivent les sensations« Écriture #2 | les morceaux d’inconnu que tu portes en toi », Gwen Denieul, 6 avril 2018.↩︎ », ce qui exige de « [s]e sentir à contretemps, créer de l’espace et du temps« Écriture #1 | réapprendre à parler », Gwen Denieul, 9 mars 2018.↩︎ ». Plutôt qu’une promenade dans l’espace physique, chez Denieul c’est seulement « l’esprit [qui] divague« Écriture #1 | réapprendre à parler », Gwen Denieul, 9 mars 2018.↩︎ », guettant l’imprévu – et les images qui accompagnent le texte plutôt que de le faire émerger :
Regarder l’espace autour de soi, se lever, ouvrir la fenêtre à guillotine, humer l’air de la nuit, et attendre, attendre l’événement. Chaque nuit serait une nouvelle aventure. La parole jaillirait au bout d’un long moment d’attente et de gribouillages inutiles. L’écriture nous submergerait ; elle emporterait tout« Écriture #3 | une solitude tenace », Gwen Denieul, 5 mai 2018.↩︎.
Le montage soigneux résonne avec le texte sans se réduire à une simple illustration. Les images oscillent entre liens directs et liens plus associatifs avec le texte, entre précision et élargissement de l’horizon du récit, tout en créant une atmosphère visuelle, renforcée par la musique extradiégétique, toujours très importante chez Denieul.
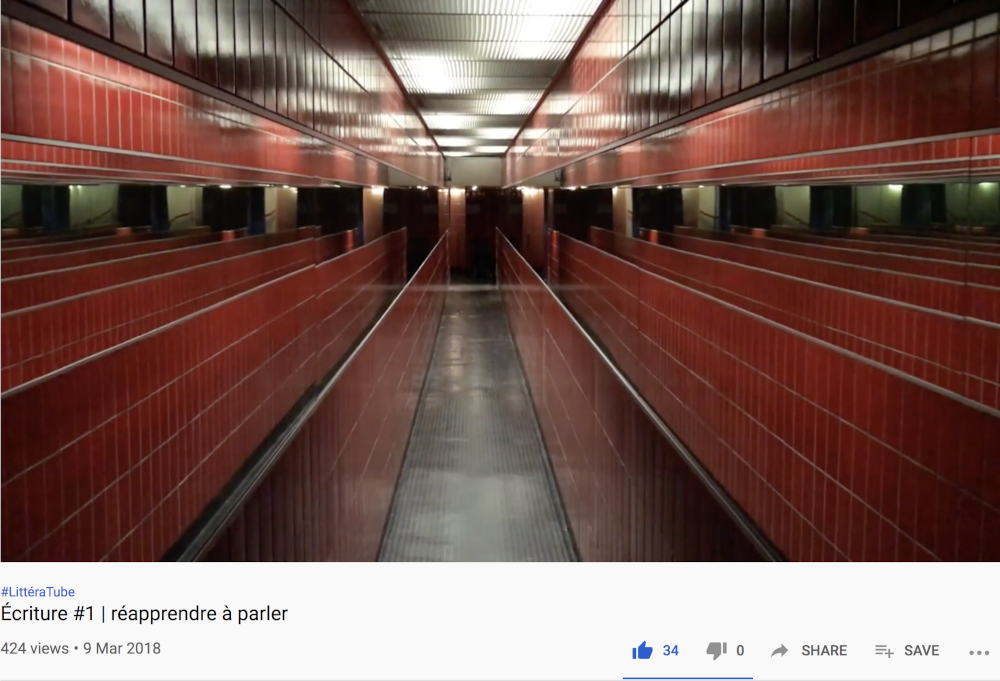
Improvisation
Les errances dans la ville et dans la tête se voient parfois accorder la parole directement, comme l’écrit Anh Mat :
Des phrases passent. Je n’en saisis qu’une poignée. Il y a en trop en même temps. Je suis submergé. La ville pose pour moi. Elle me demande constamment de la saisir. Chaque bout de trottoir est un portrait possible. Chaque fissure contient un texte en mémoire, un texte qui me préexiste, dont je reconnais la voix, trace après trace retrouvée, au hasard de la dérive (2017h).
Le concept même d’improvisation est déstabilisé par les moyens d’enregistrement numériques et la curieuse combinaison d’immédiateté et de décalage qu’ils permettent, entre enregistrement direct et manipulation facile par les logiciels de montage. La parole peut ainsi être improvisée dans le sens traditionnel de « composer et d’exprimer simultanémentTrésor de la Langue Française.↩︎ » et enregistrée en même temps que l’image visuelle de ce qui l’inspire – on voit des exemples, ou ce qui semble l’être, chez Anh Mat, Milène Tournier et Gracia Bejjani –, mais les rushes peuvent être coupés et montés en omettant ou même en replaçant ou en reprenant des bouts de texte. D’autre part, l’écriture qui apparaît comme telle peut être réalisée directement dans le logiciel de montage, comme on l’a vu chez François Bon, sous l’effet de l’image, ou prise en note dans l’espace même des prises de vue, sans être modifiée ensuite lors du montage. Un texte écrit peut ainsi être improvisé et publié sans révisions, tout comme la parole peut être travaillée avant sa performance. Quelque forme qu’elle produise, la spontanéité créatrice sous l’effet immédiat des espaces et des errances géographiques comme mentales semble aussi importante dans les vidéo-écritures que le soin apporté à la rédaction et à la composition. La flexibilité du médium vidéo permet de brouiller les frontières tout en réaffirmant l’élargissement des limites de l’écriture, qu’elle détache de l’idée par ailleurs toujours dominante d’une lente rédaction à l’écrit.
Ainsi Gracia Bejjani, dont les choix de mots et la syntaxe elliptique sont d’habitude minutieusement mesurés, lance-t-elle une série « impro » (dont les capsules seront aussi incluses dans son « micro journal »), avec des variations de sujet et de forme indiquées dans le titre des capsules : « Impro•je sors », « impro•visage », « impro•exil », et « impro même jour d’avant, empreintes (de…) ». « J’improvise sur quelques plans vidéos filmés aujourd’hui : je sors comme pour la première fois, sans intention autre. Sortir, le vent. Ne pas écrire ce soir, parler à dehors » : ainsi présente-t-elle la première expérience de ce genre, « Impro•je sors (1) ». Une suite de plans de la rue « en bas de la maison », une statuette de lion dans une vitrine, des pigeons sur le trottoir, une cour intérieure en noir et blanc granuleux, puis un arbre en fleur en contre-plongée avec le ciel bleu en arrière-fond, cette fois image lisse en couleur, ainsi qu’un sac plein de livres en plongée dans l’entrée du bâtiment, sur lequel la capsule termine. La voix off, dont la qualité et la continuité suggèrent que l’enregistrement a été effectué après le montage, parle au présent, à la première personne du singulier, du moment vécu pendant la prise de vue, mais suivant l’enchaînement des images déjà montées. La base immédiate de l’improvisation est donc ici la séquence finale des plans, déjà travaillés et transformés, qui s’insère ainsi entre l’expérience vécue et les réflexions, tout en créant l’espace et le temps pour les amplifier et approfondir. Bien que l’autrice distingue explicitement cette parole de son écriture, le processus crée une forme d’écriture vidéo qui n’est concevable que par ce médium – à l’opposé du procédé d’Anh Mat lorsqu’il se promène en ville et parle, invente l’écriture directement dans le présent et dans l’espace de la prise de vue.
L’exploration de ce mode de (non-)écriture se poursuit chez Bejjani dans les autres improvisations, dont les descriptifs réitèrent « Ne pas écrire, parler… », avec les compléments qui varient. « impro•visage (1) » dépouille la démarche encore davantage. L’autrice est retirée dans son espace privé, on ne voit que son visage entouré de noir, et elle parle (entre autres) du fait de ne pas écrire : « je ne veux pas faire de journal de confinement… je ne veux plus écrire… mais j’ajoute des phrases ». Or, ajouter des phrases devient encore écriture par la manière de faire. Malgré la proximité par la succession de gros plans qui rapproche le visage de plus en plus et un changement de position graduel qui ramène les yeux noirs au centre, le regard nous échappe. Il a l’air confus qui cherche, ou juste contemple la confusion dont l’autrice est en train de parler, entre la vanité des analyses et des tentatives de compréhension face à la guerre d’une part, et la force tout aussi incompréhensible de la joie qui survit malgré tout, comme seul moyen de survie, d’autre part. La voix et la diction transmettent aussi ce mélange de stupeur et de tâtonnement, avec les rythmes qui changent en accord avec les propos, restent fluides tout en se permettant également la pause, y compris un plan sans parole. L’improvisation donne ainsi lieu à une véritable composition, avec le montage qui « grave » les paroles et les transforme en vidéo-graphie.
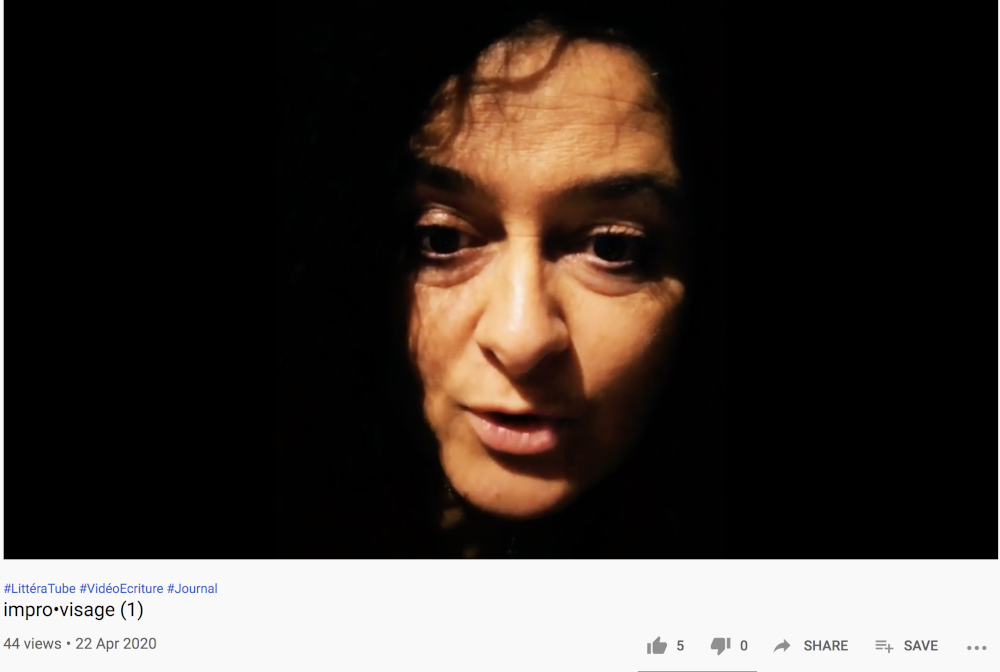
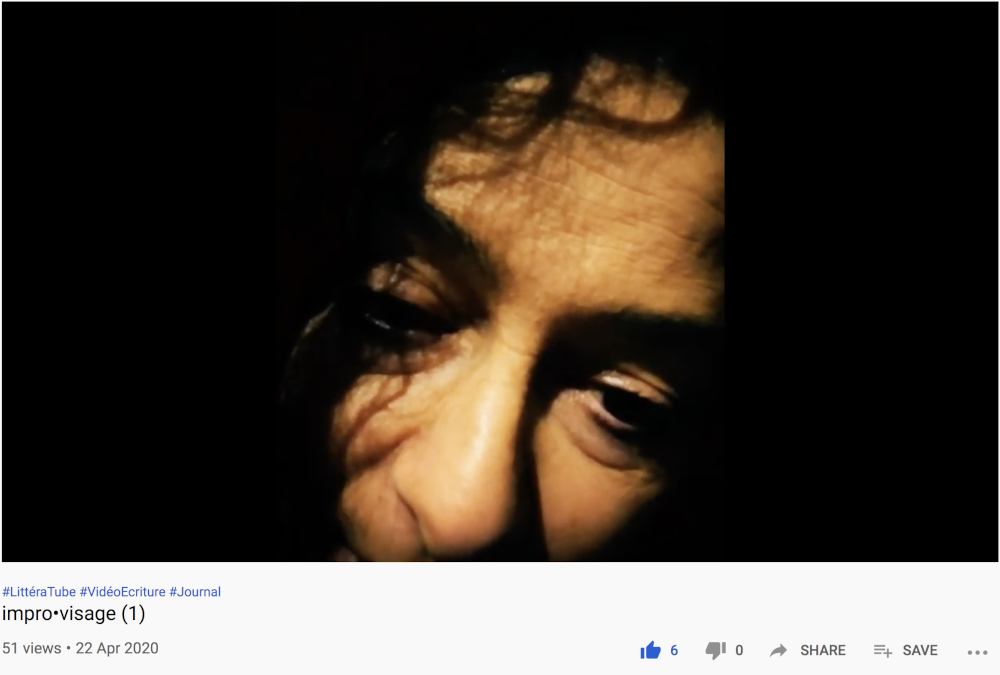
Anh Mat commente cette capsule : « C’est très beau… (Ça va faire un an que j’écris à la voix aussi… et depuis, j’ai du mal à revenir à l’écriture écrite…) », auquel Bejjani répond : « je poursuis les 2, vidéos et écrits, différentes matières mais toutes deux me sont nécessaires… ici l’impro pour tenter autre voie ». Et Anh Mat de préciser : « de mon côté, les deux se mêlent, les textes amènent la voix à les réécrire pendant l’enregistrement même… ou bien la voix improvisée rencontre des souvenirs de textes… ».
Écriture et parole, rédaction et improvisation s’entrecroisent donc. Dans « impro•visage (2) », Bejjani remet aussi en question la distinction entre les modes de naissance de la parole, au moins en partie : « On n’improvise pas. Les mots viennent, ils ont toujours été ». Et les capsules récentes d’Anh Mat, dont « Đà Lạt, filmer des phrases (2) », déjà citée, seraient donc également (semi-)improvisées.
« Đà Lạt, filmer des phrases (2) » par Anh Mat
Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.
Crédits : Anh Mat
« Je prends la caméra comme avant je prenais le carnet. Je dois noter ce que le trajet dit du regard. Je prête ma voix aux flux d’écriture derrière, ce flux continu, mon bruit de fond intérieur », y dit-il. Mais on retrouve l’improvisation chez lui comme procédé d’écriture vidéo dès 2016, dans « errance (2) », par exemple, où le bruit diégétique qui se mêle de la diction indique la simultanéité de la prise de vue et de son. François Bon remarque en commentaire : « on aurait presque envie de voir ce que tu dis s’inscrire sous les yeux en même temps que tu le dis, tellement c’est écrit ». Si la différence en style entre parole improvisée et rédaction au préalable est assez marquée chez Gracia Bejjani – la syntaxe est plus fluide et naturelle dans la première, tout en restant très soignée, et les propos plus directement liés à une situation ou émotion concrète et identifiable –, la distinction sur cette base semble presque impossible chez Anh Mat, tout comme chez Milène Tournier. Les écrits de Tournier semblent souvent nés et propulsés en vidéo sous une impulsion, et ce n’est que la diction et la qualité de l’enregistrement qui servent de quelque appui pour une éventuelle distinction. Distinction qui perd son importance donc, avec l’alliance de l’écriture, de la parole, de l’errance, de l’imprévu et de l’improvisation qui s’enrichissent mutuellement dans des pratiques de vidéo-écriture aux multiples visages.
Écrire vidéo
Le dispositif vidéo élargit le champ littéraire en mettant le texte en relation avec des images et des sons dans un cadre temporel. Nous avons vu comment la question de la composition audiovisuelle – ce que l’on appelle « montage » avec le vocabulaire hérité du cinéma, pas tout à fait adapté, comme on le verra – est également fondamentale pour l’écriture vidéo. Contrairement à la performance vidéo, souvent proposée sous la forme « crue » d’un seul plan fixe avec une manipulation minimale en postproduction, ici même l’improvisation est plus travaillée, montée en composition, avec au moins une sélection-combinaison de plans et l’ajout de textes et/ou de la voix off, et souvent d’une musique. Qu’il y ait ou non écriture au préalable, présentée sous forme de texte ou de parole, la composition audiovisuelle, tout comme dans le cas des journaux vidéo, participe donc de l’écriture. Si les hasards et la fluidité de l’errance jouent le rôle principal chez Anh Mat, avec un travail de sélection et d’arrangement des plans, et parfois un seul et même plan fixe ou une photographie qui fournit la toile de fond visuelle pour tout un texte de plusieurs minutesVoir par exemple son « Instantané #1 « Celui que je fus » » (6 mai 2020) et « Instantané #2 « rêve d’incendie » » (20 mai 2020).↩︎, l’élaboration des « spectacles » de Milène Tournier exige déjà une réflexion plus poussée sur l’organisation des plans. Le choix entre voix off et écriture sur l’image comme support s’impose également. En outre, certains auteurs jouent avec des voix synthétiques. L’alternance ou la combinaison des voix ouvre tout un champ d’expérimentations possibles dans la présentation du texte. La question de la composition dépasse parfois la capsule individuelle et s’élargit dans une stratégie de construction de séries, d’ensembles et ultimement, d’une œuvre. D’autre part, elle se prête également à une remise en question plus poussée du processus d’écriture, du texte et de la signification.
Composition
Le mode documentaire par prises de vue effectuées dans la ville ou ailleurs, qui est selon Philippe Dubois l’un des deux modes principaux de la vidéo (2012, 83), reste proche des journaux filmés. La composition par le montage successif des plans qui domine ce mode reste cependant l’héritage de la construction cinématographique de récits, comme le note encore Dubois (2012, 83). Gwen Denieul est parmi nos auteurs celui qui investit le plus cette logique cinématographique narrative dans la mesure où il a recours à la mise en scène de personnes – lui-même en lecteur-performeur de ses textes et en écrivain, à la fois auteur, narrateur et personnage de ses récitsVoir par exemple « Sauver sa peau » (2 octobre 2016) et « Écriture #1 | réapprendre à parler » (9 mars 2018). Le fait qu’il ne s’agit pas toujours de plans fixes suggère que quelqu’un l’assiste occasionnellement dans la réalisation, qui s’effectue pour le reste typiquement en solitaire.↩︎, comme d’autres personnesAinsi par exemple l’amante que le narrateur observe dans son appartement dans « Le ciel sur terre » (12 décembre 2016). La mise en scène prévaut également dans le travail du Studio Doitsu, où les textes de Noémi Lefebvre sont performés par le couple de créateurs ou illustrés par un spectacle de marionnettes en stop motion de bonhommes Playmobil.↩︎. De telles scènes directement illustratives jalonnent ses capsules tout en restant ponctuelles, et font partie de compositions audiovisuelles qui sont loin d’être de simples performances ou visualisations du récit. Ces compositions créent un espace porteur d’une charge atmosphérique dans laquelle le récit résonne. Ainsi la première moitié de « Simon et L #3 | la lenteur de son sang », par exemple, montre une surface d’eau ondulante et scintillante sous le soleil, à travers laquelle apparaissent et disparaissent en superposition des images à peine visibles de deux corps ondulants eux aussi, faisant l’amour, pendant que la voix off raconte sa passion pour cette femme mystérieuse. Le reste des images de la capsule devient ensuite moins directement lié au texte qui, quant à lui, passe de l’espoir d’un bonheur jusque-là pensé impossible au sentiment d’abandon. Tout en restant en harmonie avec l’évolution du texte, les visuels passent de vues depuis un bâtiment vide donnant sur la mer ensoleillée à des images nocturnes urbaines de rues désertes. Une belle composition mélancolique de violoncelle par Frédéric D. Oberland, portant le titre omineux de « On the Edge of the Great Precipice », sert de liant entre le début et la fin de la capsuleCe morceau fait partie de la bande-son originale par Frédéric D. Oberland du film expérimental de Jayne Amara Ross intitulé The Freemartin Calf (2010), tourné en Super 8 et 16mm, que le critique Raphaël Bassan décrit comme une « fiction quotidienne » (Amara Ross s. d.).↩︎.
La surimpression des images qu’on voit au début de cette capsule,
ainsi que la présence et la disparition spectrales de l’auteur dans
d’autres chez DenieulVoir « Il nous
fallait le dehors, le naissant », Gwen
Denieul, 7 juillet 2017.
Cf. également chapitre 7.↩︎, ne rentrent plus dans la logique
cinématographique de l’enchaînement des plans et relèvent du deuxième
mode dominant du dispositif vidéo identifié par Philippe
Dubois, le mode plastique (2012, 83). Ce mode, dont la dominance
a été ébranlée par l’explosion de la vidéo d’amateur numérique, mais
qui continue à distinguer l’expérimentation artistique avec le médium,
permet de mettre en valeur le texte en tant que matière sonore et
visuelle, enchâssée dans la matière visuelle et sonore puisée dans le
réel et retravaillée lors du montage et du mixage des images et des
sons. « Le mot est matière avant d’être discours. Avant tout
sonorité », écrit Anh Mat
(2017g),
tandis que les objets écrits trouvés dans la ville par Milène
Tournier et Gracia Bejjani, aussi bien
que les formes et les animations multiples des textes en surimpression
sur l’image, soulignent leur matérialité visuelle. Gracia Bejjani, Stéphen
Urani, Marine
Riguet et surtout Jean-Pierre
Balpe sont ceux qui vont le plus loin dans l’exploration de la
plasticité de la matière verbale sonore et visuelle.
Cette exploration est fondamentale notamment dans la réalisation de ce « projet ou fantasme : donner une autre perspective à son écriture » que Gracia Bejjani désigne comme « acte fondateur » de sa chaîne et de son écriture vidéo. Si avant de découvrir le dispositif vidéo, elle s’intéressait déjà à la photographie et avait développé une pratique de « photos-textes » dans les réseaux sociaux qui conjuguait images et micro-écritures tout en gardant les deux composantes séparées, la vidéo lui a permis d’élaborer un style marqué par l’intégration et la manipulation dialoguante des deux. Elle puise dans une archive pour la sélection des rushes plutôt que de se fier uniquement au hasard du jour et expérimente les possibilités offertes par le logiciel de montage pour travailler l’image et le son diégétique, tels les jeux sur la vitesse et les raccords, la superposition de plans et les formes d’écriture dans l’image. Ses images signature – la mer et d’autres surfaces d’eau, le ciel, les nuages et les levers et couchers du soleil, des paysages urbains et naturels du Liban natal de l’autrice, des vues depuis l’avion et des objets en gros plan, parfois des œuvres d’art –, en couleurs lisses ou en noir et blanc granuleux, dépassent souvent la représentation tout en partant et jouant d’elle. En gros plan, coupés de leur contexte, ou pris sous un angle ou avec un cadrage décalé, les objets et les espaces sont parfois difficiles à identifier et deviennent non seulement toile de fond et contexte visuel pour le texte, mais aussi texture, une surface d’écriture plastique qui continue à affirmer sa matérialité malgré – ou justement grâce à – sa manipulation numérique.




Sans se détacher de leurs origines d’objet solide tridimensionnel, ils font office de matière dans laquelle le texte est gravé et qu’il creuse, dans le sens matériel comme métaphorique. Le texte, écrit et/ou en voix off, manifeste également sa matérialité et fait partie intégrante de la texture à son tour. Le dispositif vidéo réunit ainsi les différents types de signes et de matérialités tout en maintenant une tension entre eux, tension productrice d’une dimension sémantique supplémentaire et suggestive.
Dans le « micro journal 53/2020.03.23 » (renommé « mon cœur arasé »), par exemple, on voit une structure en métal blanc en contre-plongée qui ressemble à des portes ou fenêtres ouvertes sur le mur d’un immeuble. La caméra tâtonne en petits mouvements hésitants, quatre plans se suivent en fondu enchaîné avec de légers changements d’angle, sans jamais laisser deviner la nature exacte de cet objet architectural. En surimpression, on perçoit des nuages, eux aussi avec un va-et-vient de caméra flottante, et un soupçon d’une troisième couche d’images qui apparaît brièvement, avec les phares d’une voiture qui passe et les lignes blanches sur une chaussée. La lourde masse géométrique inerte et l’amorphe légèreté aérienne se conjuguent ainsi tout en maintenant leur contraste comme des matérialités de natures opposées et se rejoignent en même temps dans l’incertitude du regard et du sens, tandis que le spectre de la route à peine perceptible suggère l’existence d’une profondeur inexplorée, inaccessible. La bande-son mixe en même temps des chants d’oiseaux avec un bruit de fond métallique sombre et ondulant, comme le passage dans un tunnel, soulignant le contraste entre l’air libre et un espace étouffantLa bande-son est encore plus importante lorsque l’autrice explore les possibilités offertes par la voix off, et en particulier le mixage du français et de son arabe natif, entre parole et écriture. « nerveuse comme mouche » (8 février 2020) offre un très bel exemple, avec la voix off en arabe qui se démultiplie en paroles superposées et entrecroisées, accompagnées par des images en noir et blanc granuleux, des travellings à travers une vitre de voiture mouillée par la pluie, avec un texte en français.↩︎. Le texte en surtitrage, d’une large police de caractère blanche avec des contours noirs sur la moitié supérieure de l’écran, parle de la guerre et de ses « séquelles à vie », dont l’écriture, seule réponse possible qui, sans rien pouvoir résoudre, aide à « durcir le réel » en le « ciment[ant] de mots inanimés ». En même temps, ce texte, d’une précision et d’une économie suggestives, reste tout aussi flottant, fragmenté et hésitant, d’un « ressac » qui « berce » et bouleverse à la fois, contredisant l’inertie déclarée des mots :




Par sa manière d’« articuler en permanence ces deux types de poéticité, verbale et visuelle [… e]n symbiose organique », pour reprendre la formule que Philippe Dubois utilise à propos des artistes vidéo Danièle et Jacques-Louis Nyst, la vidéo-écriture de Gracia Bejjani réalise elle aussi une « contamination métaphorique généralisée » (2012, 196) à travers les composantes du médium. Ainsi la vidéo non seulement intègre l’écriture et lui donne une forme nouvelle, mais devient « une forme qui pense » et qui écrit à part entière, « un état de la pensée des images » (2012, 111), mais aussi du langage.
Stéphen Urani explore également le mode plastique en mettant l’accent sur la composition visuelle et sonore de ses vidéopoèmes. Outre la stratification des images, il attribue une grande importance à l’intégration des mots, statiques ou animés, mesurés au millimètre – dans le sens propre comme figuré –, dans l’image, souvent alignés avec les objets architecturaux dont la masse tridimensionnelle est ainsi à la fois soulignée et transformée en surface d’écriture :
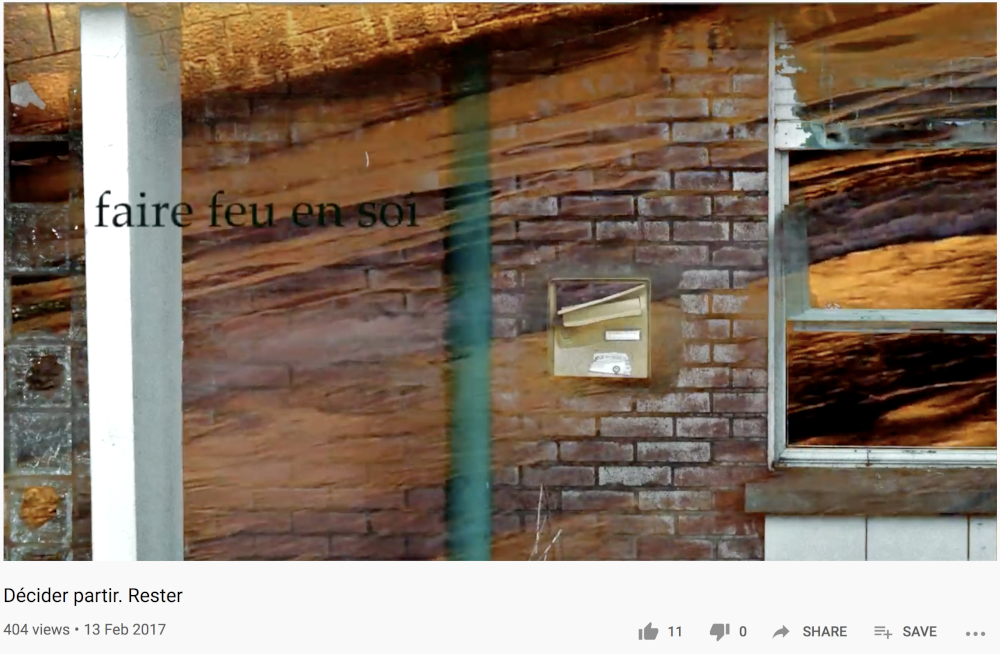



La bande-son, dont la base est toujours un morceau musicalUrani
remarque en réponse à un commentaire de François Bon sur son
vidéopoème « Haïr le musée » (cette vidéo n’est plus disponible) :
« Désespéré de ne pas savoir faire sans bande-son. C’était pourtant
– une fois de plus – le projet ici. Persuadé que les gestes que nous
tentons gagneraient en accord avec eux-même [sic] sans le
support (coloration/tonalité) musical. Mais ils perdraient en
efficacité. Merdum ! » (cette vidéo a depuis été supprimée par
l’auteur).↩︎, joue souvent avec des
combinaisons de la voix douce et ferme de l’auteur, parfois
démultipliée en écho, avec une voix synthétique, dont l’impassibilité
mécanique va contre la notion classique de poéticité, et met en relief
l’aspect intransigeant des réalités dont le texte parle, ou se moque
des discours figésC’était le cas de « Haïr le musée » (cette vidéo
n’est plus disponible).↩︎. Les propos que l’on entend et
que les mots choisis en surimpression dans l’image reprennent ou
complètent, en précisant ou en répondant aux questions de la voixVoir par exemple « Et si ça cessait ? », Stéphen
Urani, 19 septembre 2016.
↩︎, sont des réflexions
philosophiques et poétiques concises sur la vie et la ville dans
toutes leurs dimensions, avec souvent un aspect et même un message
politiqueAinsi « France » (cette vidéo a été supprimée),
« Haïr le musée » (également supprimée) ou « À un badaud », Stéphen
Urani, 26 octobre 2016.↩︎. Les relations complexes qui se
tissent entre ces textes fins, les images composites, leur
enchaînement, les jeux entre les voix et les graphies, leur
positionnement et leur rythme dans l’espace de l’image et dans le
cadre temporel de la capsule, produisent une richesse sémantique et
esthétique « en symbiose organique » ici aussi, « une sorte de magie
vidéographique totale » (Dubois 2012, 197) et poétique qui
témoigne également d’un « refus du partage entre le propre et le
figuré » (Urani
2019).
Construction
Stéphen
Urani décrit sa chaîne YouTube comme un
« [r]ecueil de vidéos-poèmesNous soulignons.↩︎ », ce qui suggère une visée à
long terme, une construction d’œuvre qui dépasse la capsule vidéo
comme unité tout en l’englobant. Tous nos auteurs et autrices, à
l’exception d’Anh Mat,
profitent en effet de la fonction « playlist » de YouTube pour créer
des séries et/ou distinguer des catégories dans leurs créations vidéo.
La plateforme permet de classer la même capsule dans plusieurs
playlists et de produire un réseau d’entrecroisements, invitant
l’auteur à réfléchir à la cartographie de sa chaîne, lui permettant de
la présenter comme un « recueil » organisé, avec des séries et
regroupements, des reprises et variations sur des thèmes, une œuvre
avec une structure, qui reste ouverte et modulable mais toujours déjà
présente dans le réseau en tant qu’œuvre. Sans forcément avoir un plan
précis pour les capsules à venir et tout en laissant libre cours aux
errances et envies, la publication au fur et au mesure de la création
fait ainsi paradoxalement qu’il y a toujours déjà construction d’œuvre
(en cours), et donc un processus d’éditorialisaion, même lorsqu’il
s’agit d’une pure « jouissance de gestes / sans velléité d’œuvre« tu ne vis pas ta
vie. », gracia
bejjani, 9 juillet 2020.
↩︎ ».
Le terme de « recueil » suggère en même temps que ces
vidéo-écritures, tout en incarnant un mode d’émancipation face aux
formes et infrastructures littéraires traditionnelles, continuent à
être hantées par le spectre du Livre, même lorsque celui-ci apparaît
par son absence ou sa négation : « écrire, sans livre à venir »,
déclare Gracia Bejjani« écrire
l’écrire 8 : ressac », gracia
bejjani, 4 février 2019.
↩︎. Cette écriture est à la fois
définie et animée par la tension entre la plateforme de masse qui
exige la vitesse et la finesse d’un travail artistique qui résiste à
la production et à la consommation rapides et superficielles. Elle est
ainsi prise entre la dynamique du flux et l’invitation à prendre son
temps, entre le mouvement des réseaux et le sérieux qu’exige le Livre,
de la part de l’auteur comme de la part du lecteur. « Je souhaite que
le livre à venir préserve ce mouvement, celui entre la ville, l’homme,
et la lumière », dit à son tour Anh Mat« la marche
des mots », Anh Mat, 10
juin 2019.↩︎, dont l’écriture vidéo, tout
comme son blog, tourne autour de ce fantasme du « livre à venir »,
projet réellement en cours de réalisation puis abandonné, mille fois
repris et renoncé, et qui devient une figure centrale du destin
reliant écriture, ville, auteur et lecteur :
le livre à venir est peut-être une suite d’échecs de tant d’autres livres avortés. Morts-nés. Tout comme la ville, qui ne cesse de faire apparaître et disparaître quelque chose, à un rythme bien plus effréné que celui des vagues. Il faut garder le caractère d’apparition de l’écriture, la laisser vivre sa vie, avec le lecteur. Être sans me soucier de savoir qui je suis. Laisser les mots m’écrire, m’échapper, me refaire le portrait, un portrait mouvant qui n’éprouve plus de gêne à dévoiler ses traits (2017f).
Il est toutefois peu anodin que le (mot) livre cède littéralement sa place à (la) « vidéo » (ou au « film ») que l’auteur est en train d’« écrire » lorsque le texte de ce billet devient l’objet d’une remédiatisation et donc d’une réécriture en vidéo deux ans plus tard dans la capsule intitulée « la marche des mots ». Malgré cette réalisation explicite, l’obsession du livre reste intacte et se confond avec le fantasme d’une « Écriture » toujours à venir, jusqu’à ce que celle-ci ne quitte l’auteur, selon une série de récits qu’il écrit et présente en vidéoVoir Les nuits échouées, #578-#594 et « Les heures miroirs #1 “l’écriture est partie” » (19 juin 2020).↩︎. Sans parler explicitement de livre, les personnages-avatars de Gwen Denieul semblent également hantés par une écriture qui cherche son chemin vers un accomplissement désiré bien que jamais nommé. L’analyse de l’approche godardienne par Philippe Dubois résume bien l’expérience d’écriture et de construction d’une œuvre (ouverte) dont témoignent ces vidéo-écritures :
Ce qui est fondamental pour Godard, ce n’est pas d’avoir fait un film (ou d’en préparer un), […] c’est plutôt d’être toujours en train d’en faire un, qu’il tourne ou non, qu’il monte ou non. Faire un film pour lui est une chose extensive et totale, c’est être et c’est vivre, c’est à tout instant être branché sur les images, c’est voir et penser ensemble. C’est tout cela, « écrire » : conce-voir et rece-voir. Avec la vidéo ainsi utiliséeIl s’agit des scénarios de film sous forme de vidéo, mais sa conclusion sur la relation entre vidéo et écriture semble correspondre à l’esprit de nos auteurs vidéo et à leur rapport à l’Œuvre, quelle que soit sa nature.↩︎, c’est à une véritable extension de la conception même de l’écriture que l’on assiste. Voir, Penser, Écrire, cela revient au même. Et cela passe par la vidéo (Dubois 2012, 237).

Déconstruction
Le fait que l’écriture se conçoive et se pratique en tant que processus, flux et errance en même temps que composition structurante et construction d’œuvre, et qu’elle se démultiplie en processus d’écriture au sens propre, improvisation, prise de vue et de son, montage et mixage, participe déjà d’une sorte de déconstruction et d’explosion du geste d’écrire et de l’art littéraire – sinon même de leur disparition en tant que telsComme Anh Mat le précise à propos de son blog dans une réflexion qui vaut également pour son écriture vidéo : « le blog est aussi vivant qu’un brouillon. Mon blog est un mouvement de pensée dans un livre à durée indéterminée. Écrire sur le web me met en rapport avec la mort du texte même. Pas de postérité possible, d’un jour ou l’autre, tout peut s’arrêter. Je ne sauvegarde d’ailleurs rien » (2017c).↩︎. Jean-Pierre Balpe pousse cependant le défi bien plus loin encore, jusqu’à son extrême : il remet en question non seulement l’idée (ou le désir, ou l’illusion) d’une trace écrite linéaire atemporelle, mais aussi la notion de sens, étroitement associée au langage et à l’écriture, dans sa construction (par le processus d’écriture) et sa reconstruction (par la lecture). Le spectre du Livre hante cette fois non plus en tant que désir ou horizon ultime de l’écriture, mais comme incarnation d’une doxa culturelle contre laquelle les œuvres de littérature numérique se révoltent :
Le livre EST le problème ; le livre est tout le problème… ou plutôt l’industrialisation du livre et tout ce que, dès son origine, elle implique et qui, peu à peu, s’enchaîne dans un ensemble de dispositifs de plus en plus contraignants : la standardisation, le formatage, les conventions, les collections, le marketing, les publics, les critiques, les auteurs, les autorités et les genres… (Balpe 2001, 9‑15).
Car dans l’œuvre de alpe, l’art vidéo et la vidéo-écriture se conjuguent justement avec la littérature numérique. Créateur et théoricien, pionnier de la littérature numérique dès les années 1970, Jean-Pierre Balpe est une figure phare de la génération automatique de textes. Son travail, d’abord présenté sous forme d’installations, d’expositions et de disquettes, a trouvé son milieu idéal sur la Toile, qu’il a vite investie en multipliant les blogs et en créant un univers rhizomatique sous le titre de La Disparition du Général ProustPour une présentation générale de ce projet, voir le répertoire des arts et littératures hypermédiatiques.↩︎. Ce projet continue désormais dans l’« univers de génération automatique littéraire » hébergé sur le site balpe.name, « la page d’entrée principale de l’hyperfiction en flux et expansion continue “Un Monde Incertain” basée sur la génération automatique de textes littéraires ». Ce site, et ce monde incertain, sont constitués d’un ensemble de « dédales » destinés à déboussoler le visiteur entre des générateurs interactifs qui lui permettent de générer « ses » propres textes uniques et éphémères dans un genre ou sur un thème donnéVoir par exemple « Un début possible » de roman (la page n’étant plus disponible, nous renvoyons à la version archivée) ou « Poèmes Lyriques ».↩︎ et les créations vidéo de l’auteur à partir de tels textes générés. Les réseaux sociaux, notamment Facebook, ont également ouvert un espace idéal pour accueillir ce monde incertain, qui y existe désormais comme une « installation numérique », avec toute une série de profils de personnages-auteurs fictifs qui publient des textes, générés par le logiciel de Balpe ou écrits par lui – il n’est pas toujours facile de distinguer les deux – et des vidéos qui leurs sont attribuées.
Balpe présente la génération automatique de textes littéraires comme une « déshumanisation positive de l’écriture » qui explore et exploite « la puissance fécondante de la langue en tant que telle » et « ne désire être que l’instant éphémère et transitoire d’une permanente et commune littérarité » (1994). Il s’agit d’« une maximalisation de l’infini sémantique par examen systématique et décontextualisé des moyens formels de l’expression ». Elle instaure aussi « un rapport radicalement nouveau à la lecture » dans la mesure où « le lecteur n’est plus renvoyé qu’à lui-même » (1994), puisqu’il n’y a plus d’auteur dans le sens traditionnel de celui qui aurait choisi les mots et attribué un sens au texte, ni de contexte : aucun point de repère ni référence stable donc. Cette « béance » sémantique portée par une grammaire et une syntaxe correctes reste cependant paradoxalement un « générateur de sens », un espace de jeu linguistique pour le lecteur qui est laissé libre de créer un/du/des sens, plutôt que d’être censé chercher « le » sens prédéterminé.
Ce sont de tels textes qui constituent donc la composante verbale de la vidéo-écriture balpienne. Celle-ci est organisée en playlist, séries thématiques, et « SaisonsDe nombreuses séries sont mélangées dans la playlist qui préserve la chronologie de la publication. Comme la création ne suit pas un ordre thématique et que la playlist contient à fin juin 2020 déjà plus de 700 capsules, il est difficile de reconstituer les séries. Tout comme dans le réseau labyrinthique du site de l’auteur, constitué d’un ensemble de « dédales », la suggestion d’un ordre n’empêche pas que le visiteur-visionneur soit complètement déboussolé. On peut compter cette démarche parmi les stratégies de défi aux attentes et de subversion du sens de Jean-Pierre Balpe.↩︎ » sur la chaîne YouTube de Balpe, attribuées aux auteurs-personnages d’Un Monde Incertain, comme le précise la présentation de la chaîne :
Les vidéoséries sont une œuvre collective réalisée sur la base de la génération automatique de texte. Chaque réalisateur se voit imposer deux conditions : ne pas excéder une durée de quatre minutes et utiliser obligatoirement des textes provenant du générateur Un Monde Incertain accessible sur www.balpe.nameCela n’empêche pas la présence de phrases et de fragments de texte manifestement rédigés par Balpe lui-même, comme la clarté et la cohérence théorique de certaines affirmations le suggèrent, notamment dans la série EndoTextes, comme par exemple dans « EndoTexte 22 » (20 avril 2020) : « Nous savons que les textes sont emportés par un mouvement qui leur est propre. »↩︎.
La composante visuelle, quant à elle, puise dans des archives cinématographiques, télévisuelles ou personnelles – y compris des photos, animations et photos ou fac-similés numériques de pages de livre, de matériaux imprimés, de manuscrits… –, ou mixe des images entièrement synthétiques à base de textes, tandis que la bande-son mixe des voix synthétiques, et plus rarement celle de Balpe, avec de la musique, souvent de type cabaret ou synthétique. Les séquences de films anciens ou de vidéos d’amateur peuvent être proposées sans aucune modification de l’image, avec simplement l’ajout du texte en voix off ou l’insertion d’un surtitrage et/ou de cartons, de musique et/ou de bruitage. Le contenu visuel peut avoir un lien évident au « sujet » de la capsule indiqué par le titre, telle des scènes de guerre et de militaires dans la série « La Guerre », ou de la vie urbaine dans « Villes », mais pour d’autres séries, notamment celles dotées d’un titre plus abstrait, la relation texte-image reste plus ouverteVoir par exemple « Intrigue », « Suites », « Scaenarum » ou « Unsicherheit ».↩︎. Ces images recyclées sont aussi souvent mixées et montées en mode plastique avec surimpression, changements de vitesse et de rythme, distorsion, découpage et enchaînements rapidesSans être professionnel, Balpe mobilise tout le potentiel d’un petit ensemble de logiciels gratuits et professionnels pour jouer avec chacune des composantes du médium : Audacity et Garageband pour le son, iMovie et Motion pour les montages et « très rarement d’autres comme Final Cut, mais les 4 premiers sont très riches en possibilités », et Photoshop et Pixelmator pour les images (communication personnelle de l’auteur).↩︎ :
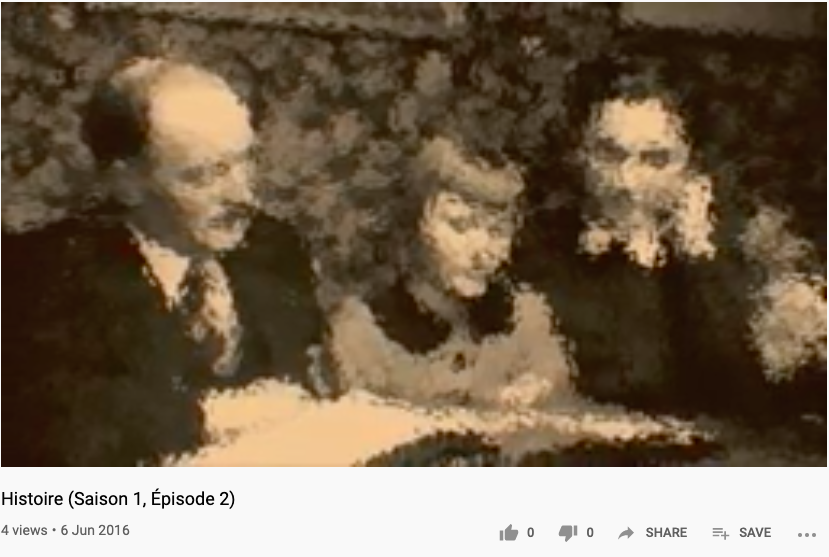
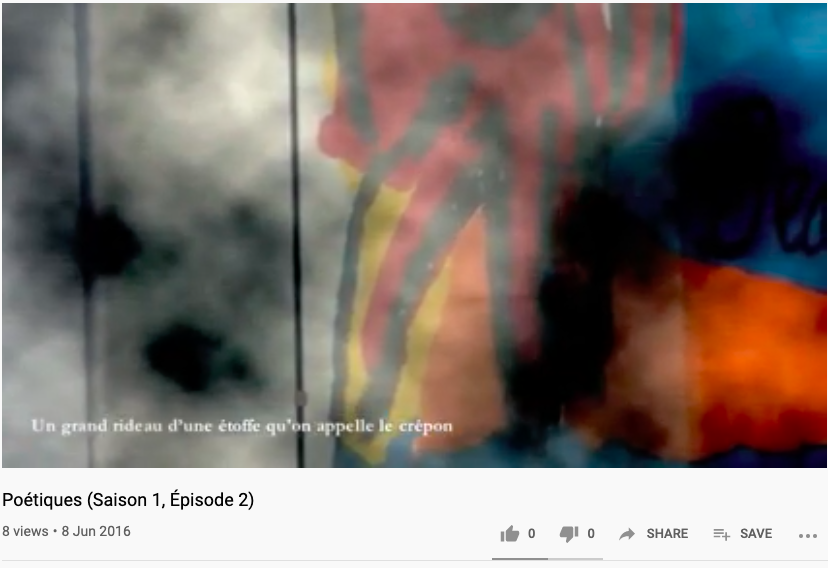


Les (dé)compositions ainsi produites résistent à toute tentative de
(re)constituer un récit classique cohérent avec un début et une fin ou
tout autre « message » clair. Comme cette rare profession de foi
simple et explicite en vidéo sur la vanité de l’écriture et le manque
d’intérêt de tout récit linéaire et rationnel le précise« Écrire
(Saison 1, Épisode 1° », Jean-Pierre
Balpe, 25 décembre 2015.
↩︎ :

Les images synthétiques, quant à elles, notamment dans la playlist « Écriture animée » et la série « EndoTexte », vont encore plus loin et expérimentent la création numérique graphique en jouant avec la forme et l’animation de textes, textures, surfaces et espaces. Ces courtes capsules d’une demi-minute chacune se dispensent ainsi pour la plupart de toute représentation figurative visuelle pour « essay[er] de poser quelques réflexions sur le texte et l’écriture », comme le précise le descriptif d’« EndoTexte 1 ». Elles construisent et déconstruisent des textes devant nos yeux, en plusieurs couches, directions, couleurs, tailles, formes et à plusieurs vitesses en même temps, de manière à les rendre pratiquement illisibles, à part les fragments qu’on peut attraper dans le flux, et souvent une phrase clé :


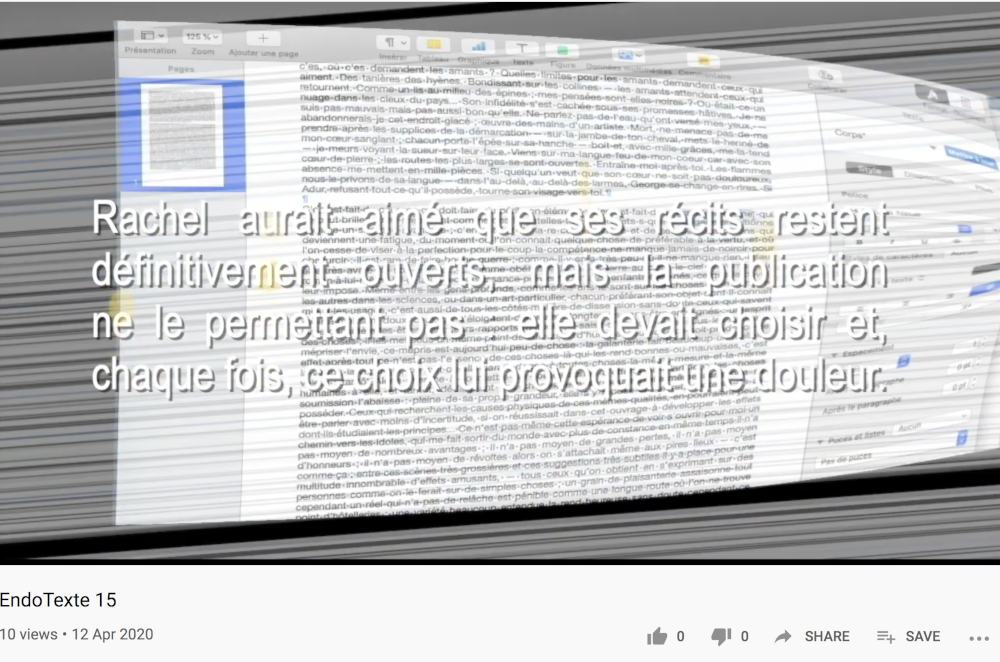
Cette série semble ainsi réaliser visuellement le rêve de la littérature numérique en proposant « un texte qui bouge, se déplace sous nos yeux, se fait et se défait » (1994). Or, comme la phrase clé d’« EndoTexte 15 » le déplore, ce qui est un événement textuel singulier en sortant du générateur devient micro-œuvre figée avec la mise en vidéo, malgré tout le dynamisme visuel du contenu : le vidéo-texte ne disparaît pas pour toujours lorsqu’on passe au suivant comme sur le site du générateur, et le quasi-illisible peut être rendu lisible en re-visionnant la capsule ou en la mettant sur pauseOn peut bien sur contourner le caractère éphémère de tout texte généré en les copiant et collant dans un fichier ou en prenant une capture d’écran pour les sauvegarder. Cette option n’est cependant pas prévue par le logiciel, qui ne facilite pas l’exportation des textes. Il ne peut en outre empêcher l’usage dans ce but des autres dispositifs qui l’entourent sur l’ordinateur.↩︎. En même temps, une deuxième, troisième ou énième lecture ne nous mèneront pas plus loin dans une quête « du sens » de la capsule. Elle ne peut qu’élargir et réduire à la fois l’espace de jeu sémantique qu’ouvre la mise en relation de mots. Qu’on relise un texte généré ou qu’on en lise un autre ne change pas grand-chose de ce point de vue : il n’y a pas de sens perdu puisque n’a de sens que celui que l’on construit. Comme l’auteur le disait à propos de La Disparition du Général Proust :
C’est une œuvre impossible à lire de façon conventionnelle, il faut se promener à l’intérieur, accepter de basculer d’un récit à un autre […]. C’est une mise en scène du flux sur lequel on ne peut obtenir que des moments de regards (Catala 2013).
Exploitant le dispositif vidéo et le mode plastique pour saturer ces regards, la vidéo-écriture balpienne est aussi un art audiovisuel qui participe du « spectacle », mettant encore en évidence une caractéristique fondamentale de la littérature numérique :
La littérature informatique, et c’est aussi en quoi elle déroute, se veut du côté de la superficialité effusive du spectacle. Elle veut concilier définitivement l’activité littéraire et l’activité ludique : détacher la littérature de la sphère de sérieux révérenciel et mortifère où l’enferme toute tradition « classique » (Balpe 1994).
Enfin, s’emparant du concept d’anopticon proposé par Olivier Auber (2019), l’auteur formule les enjeux que souligne son approche de la littérature dans le contexte médiatique et épistémologique contemporain :
Nous ne sommes plus dans une vision linéaire et massivement ordonnée du monde mais dans une approche diffuse, fragmentée, instantanée, explosée sur de nombreux écrans différents et autres supports. Cette nouvelle conception de la perspective implique une plus grande importance accordée aux comportements individualisés qui s’adaptent à des changements incessants et ceci d’autant plus que s’ajoutent un ensemble d’échanges constants entre individus dans une forme de collaboration ouverte et en perpétuelle réadaptation (Balpe 2021).
Écrire le geste
Les vidéos consacrées à l’écriture croisent parfois le champ de la vidéoperformance. Abordée jusqu’ici dans sa dimension profératrice, recourant dans sa grande majorité, sur YouTube, au format de la talking head et à la lecture ou profération à voix haute, la vidéoperformance se manifeste également sur la plateforme par des propositions centrées sur le geste même d’écrire. Ces vidéos consacrées au geste d’écrire se présentent en effet comme des poèmes achevés, et non comme des documentations du processus créatif. Dans ce contexte, filmer le geste d’écrire peut conférer au vidéopoème une dimension réflexive, au sens où l’idée même d’une vidéo-écriture s’y voit interrogée, dans une confrontation, parfois problématique, de plusieurs types d’écritures ou de dés-écritures. Les vidéoperformances d’écriture relèvent, de fait, d’un paradoxe, d’une tension entre plusieurs formes d’écriture : l’écriture scripturale, elle-même potentiellement plurimédiatique, s’y conjugue à l’écriture vidéo, par des choix divers, de la webcam au filmage d’un écran au téléphone portable, ou encore à la capture vidéo.
Le fait de filmer l’acte d’écrire n’est pas en lui-même nouveau : le cinéma regorge, par exemple, de figures d’écrivains, et le processus créatif y est parfois représenté. Cependant, l’acte en lui-même est souvent relégué « aux marges du film » (Cohen 2017), du fait du caractère relativement infigurable d’une activité généralement statique : « […] le temps propre de l’écriture est lourdement affecté par la sédentarité de l’écrivain et l’uniformité de l’action (l’encodage du texte sur la page) ; et qu’apprend-on, par ailleurs, à regarder un écrivain… écrire ? » (Cléder 2009, 189). Alain Boillat va jusqu’à parler d’un « déni de l’écrit à l’écran » (2010) au cinéma. Axé sur l’action, « l’extériorité des êtres et l’immédiateté de la perception visuelle », ce dernier peine à représenter un acte inscrit dans la durée, marqué par un repli peu spectaculaire. Hors fiction, les films montrant des actes de création littéraire, comme les documentaires sur l’écrivain à l’œuvreComme la célèbre série « Un siècle d’écrivains », diffusée entre 1995 et 2001 sur France 3.↩︎, semblent rencontrer des problématiques de figuration de l’acte d’écrire qui croisent celles du cinéma de fiction. Au-delà des raisons évidentes de chronologie, les images se focalisent moins sur le geste de scription, énigmatique et privé (rares sont les écrivains qui se laisseraient filmer en train d’écrire, sauf à rejouer le moment pour la caméra), que sur des documents manuscrits, parcourus en gros plan par la caméra, parfois accompagnés du texte lu en voix off, donnant accès à une proximité plus grande avec l’acte de création par la monstration de l’idiosyncrasie scripturaleCe qui ne va pas sans une forme de fétichisation du manuscrit.↩︎ de l’auteur, rejoignant en cela les enjeux des expositions littéraires, où le manuscrit, comme le préconisait Paul Valéry, permet de
remonter au plus près de la pensée et [de] saisir sur la table de l’écrivain le document du premier acte de son effort intellectuel, et comme le graphique de ses impulsions et variations, de ses reprises, en même temps que l’enregistrement immédiat de ses rythmes personnels, qui sont la forme de son régime d’énergie vivante : le Manuscrit original, le lieu de son regard et de sa main où s’inscrit ligne à ligne […] tout le drame de l’élaboration d’une œuvre et de la fixation de l’instablePaul Valéry, cité par Claire Bustarret (2010, 159).↩︎.
Il est, ainsi, « le témoin d’une pensée en action » (Rigogne 2015, 153‑64), et fixation du geste autographe, fonctionnant sous « le régime indiciaire de la trace » (Bustarret 2010, 160). En complément ou remplacement du manuscrit, l’écriture est suggérée par le filmage de l’environnement immédiat de l’écrivain : table, fauteuil, bibliothèque, matériel d’écriture (machine à écrire, plume, encre, papiers, carnets, stylos…) apparaissent comme autant d’accessoires ou de panoplies renvoyant à l’imaginaire de la création littéraire, abondamment exploités dans les « expositions documentaires d’objets liés à la production littéraire », présentant « des reliques, des fragments, des objets renvoyant à la sphère intime, à des processus d’écriture » (Glicenstein 2015, 41‑52). Le geste physique de création que l’on montre par l’image animée est bien plutôt le geste artistique, celui du peintre, ou du sculpteur à l’œuvre. De nombreux films d’art sont ainsi, depuis les années 1920, consacrés au travail de tel artiste montré en action, en train de peindre, par exemple dans la série « Schaffende Hände (Mains créatrices) » de Hans Cürlis, série de portraits d’artistes comme Alexandre Calder ou Wassily Kandinsky au travail pendant l’élaboration d’une œuvre. Dans cette série, comme dans Le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot (1956), ou encore les films de Luc De Heusch sur DotremontDotromont-les-logogrammes, Luc De Heusch, 1972, 14 min.↩︎ ou Alechinsky, le geste créateur fait l’objet d’une attention fascinée, voire d’une fétichisation : l’artiste y est représenté dans une lutte contre la matière, et une représentation finale est proposée au spectateur. Le geste artistique y apparaît bientôt comme une chorégraphie improvisée, que les films de Hans Namuth et Paul Falkenberg sur Jackson Pollock et l’action painting viendront autonomiser, renversant l’attention sur le processus davantage que sur l’œuvre achevée.
Hormis dans le cas particulier de la calligraphie d’un Dotremont, le geste d’écrire, quel que soit son médium, n’est pas immédiatement identifiable comme un acte créateur : tracer des lignes sur une feuille, taper à la machine ou sur ordinateur est, en soi, un geste banal. Son caractère ténu, et non marqué, le rapproche alors de ce que Barbara Formis désigne comme « geste ordinaire » dans Esthétique de la vie ordinaire. Pour la philosophe,
Un geste désigne l’émergence du corps humain au-delà de la finalité concrète de son exécution (ce qui constitue une action), mais en-deçà de l’automatisme mécanique de son déroulement (ce qui correspond à un mouvement) (2010, 18).
Considérant que notre comportement est déjà un artefact, et peut, de ce fait, prétendre au statut d’œuvre d’art telle que la définit Nelson Goodman, Barbara Formis distingue ainsi le geste ordinaire du geste artistique. L’attention esthétique au premier amène à « considérer les gestes suffisants en eux-mêmes et non pas comme des moyens de production » (2010, 33), contrairement au geste d’un sculpteur travaillant le marbre : « l’esthétique des gestes ordinaires produit une tension entre l’œuvre et sa production » (2010, 33). Ainsi envisagé, filmer et montrer le geste d’écrire relève alors moins de la documentation d’un acte créateur ou de la conservation de « l’aspect transitoire, fugace, éphémère du travail d’un artiste ou d’une œuvre qui nécessite un long processus » (Frangne, Mouëllic, et Viart 2013) que de la fixation d’un geste. C’est alors davantage vers l’histoire de la performance et de la vidéoperformance qu’il convient à nouveau de se tourner, dans son attachement à attirer le regard sur des gestes ténus, insignifiants, tels qu’ont pu le proposer Vito Acconci ou Fluxus, et à user des ressources propres de la vidéo (autofilmage et gros plan) pour ce faire. En outre, lorsque le régime de publication est vidéonumérique, l’écriture ne fait plus partie de la genèse de l’œuvre, puisque celle-ci n’est pas une œuvre d’écriture, mais bien une vidéo : l’écriture, et son geste, en sont le contenu. Libéré de son unique symbolique créatrice, le geste d’écrire se charge de valeurs diverses. Écrire y devient un geste au sens plein, révélant cette aptitude à « signifier à même le corps » (2011, 19), selon la formule de Michel Guérin.
Montrer le geste d’écrire dans une vidéo nativement publiée sur YouTube relève enfin d’un troisième ensemble contextuel, lié cette fois spécifiquement à la plateforme. Sur YouTube en effet, le geste d’écrire apparaît dans des vidéos d’autres genres, qui s’apparentent davantage au tutoriel : une recherche avec des mots clés tels que « écriture », « geste d’écriture », « geste d’écrire », met en évidence une proportion importante de vidéos proposant des méthodes pour améliorer son écriture, au sens de création littéraire (dans des tutoriels d’écriture poétique comme le proposait la chaîne Arche), de technique d’expression, ou bien encore des techniques pour acquérir une belle écriture cursive, à destination des enfants en apprentissage ou des adultes souhaitant améliorer leur graphie. Le dispositif y est souvent similaire : gros plan sur une main dotée d’un stylo plume traçant soigneusement les lettres et formant les mots sur une feuille, ou encore capture vidéo d’un tracé directement à l’écran, accompagné d’un commentaire ou de la lecture des mots tracés en voix off. Les captures vidéo d’écran quant à elles relèvent souvent également de l’explication guidée de l’utilisation de tel ou tel logiciel (comment effectuer une opération sur Excel par exemple, explications à l’appui), ou encore du jeu vidéo dans le genre du gaming. Si ces genres ne sont pas nécessairement convoqués par les vidéoperformances ici examinées, la réception du spectateur-utilisateur de YouTube s’en trouve néanmoins nécessairement informée par son expérience de la plateforme, et des effets de résonance ne manquent pas de se créer, dès lors que, comme cela a déjà été souligné, publier sur YouTube ne revient pas à implémenter une œuvre dans un « monde de l’art », mais dans un tout-venant de l’ordre de l’ordinaire.
Tracer
Plusieurs vidéoperformances enregistrent ainsi un acte scripturaire. Ni archives ni documentations de performances d’écritures, elles montrent un acte de scription réalisé pour être filmé, devant l’œil fixe d’une webcam, ou d’une caméra braquée sur une feuille. Le plan fixe largement dominant installe un cadre au sein duquel se déroule la performance. Contrairement aux dispositifs de filmage à l’œuvre dans les journaux filmés par exemple, l’auteur-performeur est dans le cadre, mais de façon partielle, devenant un « corps-dispositif » : son corps est à la fois hors champ, présent par son point de vue lorsque l’angle de vue plongeant se confond avec son regard sur la feuille, et dedans, ses mains écrivantes en action. Mais il peut aussi se dédoubler, via l’angle de vue prédéterminé, et fixe, d’une webcam, braqué en angle frontal sur les mains en action comme un témoin extérieur et neutre.
L’imaginaire du tracé s’inscrit, dans les vidéopoèmes de Giney Ayme, dans le paradigme du graphein : « il y a de l’écorchure dans l’écriture : blessure superficielle (Guérin 2011, 56) ». Deux vidéopoèmes sans paroles implémentés sur la chaîne YouTube du poète en témoignent. « Plumerage » (2006) montre un plan fixe sur une feuille, où la plume d’un stylo laisse d’abord tomber des gouttes d’encres, étalées par le stylo puis, par passages successifs en venant à saturer la surface définie par le cadre, et à déchirer le support. Le son du geste d’écrire, de griffonner puis de déchirer la page sous l’effet du surplus d’encre est amplifié. « Sur la durée des images » (2004) se focalise également sur l’écriture d’un texte à la plume. Filmé en gros plan, le support n’est que partiellement visible, et l’on ne perçoit là encore que l’extrémité du porte-plume traçant les mots à vitesse rapide. Le texte est entrevu, partiellement lisible puis peu à peu recouvert par sa propre réécriture, dans « une chorégraphie scripturale qui donne à voir et à entendre l’instant en réécrivant jusqu’à saturation : élargir le champ de l’œuvre poétique vers l’apparition d’un réseau originel de graphes bruyants que j’écris rageusement à la plume : écrire !… » L’amplification du bruit produit par les chocs successifs de la plume sur le papier constitue le seul son du poème, tout entier centré sur les mouvements du tracé, et la matérialité des instruments et supports de l’écriture. La temporalité inhérente à la vidéo rend compte, par autorecouvrements successifs des signifiants, d’un parcours du lisible vers l’illisible, un illisible « matériel » au sens où le définit Jean-Jacques Lecercle, c’est-à-dire
le résultat d’une opération, sur un texte pas si princeps que cela (dans la mesure où il n’est que pré-texte), imposé, définitivement, par un auteur qui est aussi un graphiste (ce qui veut dire qu’il n’y a ni encodage ni encodeur, l’image n’étant pas le résultat de la performance d’un code), et qui n’est pas si pervers, puisqu’il ne cherche plus à cacher le sens, à dérouter la lecture immédiate, […] : il cherche à construire une œuvre, qui n’est plus seulement, ou plus du tout un texte, étant principalement visuelle et utilisant le texte comme simple prétexte et matériau (2006, 14).
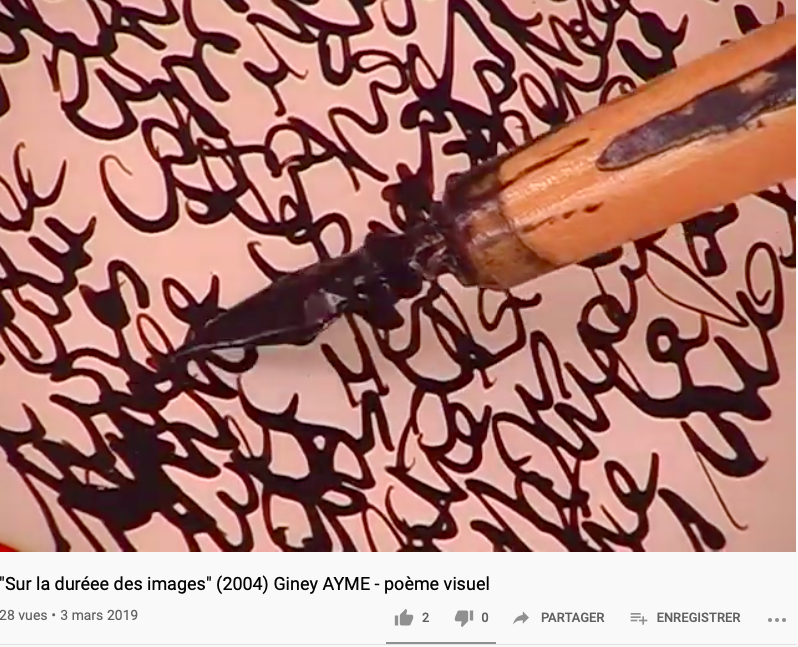
L’illisibilité matérielle à laquelle aboutit le geste de scription répété durant la vidéo contraint ainsi le lecteur « à concentrer son attention sur la matérialité du texte » (Lecercle 2006, 22), mais donne également, de par « la durée de l’image » comme l’indique le titre, à assister au passage du signe graphique au signe plastique, tels que définis par le Groupe μ dans le Traité du signe visuel (1992), par le biais d’un processus qui devient lui-même le sujet de l’œuvre : une choré-graphie dont seul l’outil vidéo, par le gros plan et l’amplification qu’il autorise, peut rendre compte. En ce sens, la vidéoperformance relève d’une forme d’action-writing, tels qu’ont pu les immortaliser les films sur les logogrammes de Dotremont, à ceci près que de poème inscrit définitif, exposable, il n’y a point : l’enregistrement vidéo en tient lieu, et c’est précisément par celui-ci que le geste d’écrire devient œuvre, y compris sonore. La matérialité de l’écriture est alors aussi celle du son qu’elle produit : « La vidéo est fière de sa matérialité, de sa physicalité, et se comprend mieux en termes de son, qui s’associe de manière beaucoup plus proche que la vision au corporelGary Hill cité par Françoise Parfait (2001, 214).↩︎ ».
Ce sont encore les mains d’Armand
le poète, double dysorthographique de Patrick
Dubost, que l’on voit à l’œuvre dans les vidéos publiées sur sa
chaîne. Ce dernier publie depuis 1995 des poèmes exclusivement
manuscrits dans une écriture enfantine, gorgée de fautes d’orthographe
et de ratures. Les textes existent en version livresque, mais aussi en
vidéopoèmesVisibles sur le site d’Armand le
poète : vidéopêms.↩︎, dont le dispositif invariable
centre l’attention sur le geste d’écriture. Dans ces petites séquences
numérotées d’une minute environ, un plan fixe en caméra subjective
surplombe une feuille de papier blanc dont on ne perçoit pas les
bords. Un générique montrant la signature manuscrite d’Armand
en papiers découpés titre la série et donne le numéro du poème. Les
papiers sont ensuite balayés par la main, et la surface de l’écran se
confond avec celle d’une feuille blanche. La main dotée d’un marqueur
noir écrit alors des petits poèmes en forme d’aphorismes ou
d’adresses. Une fois le texte inscrit, un autre objet – ou série
d’objets – est posé sur la feuille, parfois animé, comme dans « Poême d’amour n°2 », ou des
allumettes sont déversées sur le poème puis se déplacent, incarnant,
peut-être, les 728 « jolies femmes » comptées depuis le matin évoquées
par le texte. Le tout disparaît enfin pour laisser le papier blanc
prêt à recevoir de nouveaux poèmes après un générique de fin. Les
vidéos sont, là aussi, muettes, mais sonorisées par une musique
composée par Laurent
Vichard. Au cours de l’écriture, la main s’arrête, semble
hésiter, des fautes d’orthographe sont commises, puis barrées, ou
repassées pour être corrigées, des mots écrits, puis barrés et
remplacés par d’autres (« Vidéopoêm n°18 » : « un
homme amoureux n’a pas d’ombre / il est régulièrement
traversé renversé par le soleil doute »)
laissant penser à une improvisation captée par la vidéo, et, dans ce
cas précis, à la progression du doute thématisé dans le texte, qui
fait revenir le poète sur les mots qu’il a déjà tracés. La rature est
alors préférée à l’effacement, en ce que cette dernière laisse
apparaître le mot biffé.
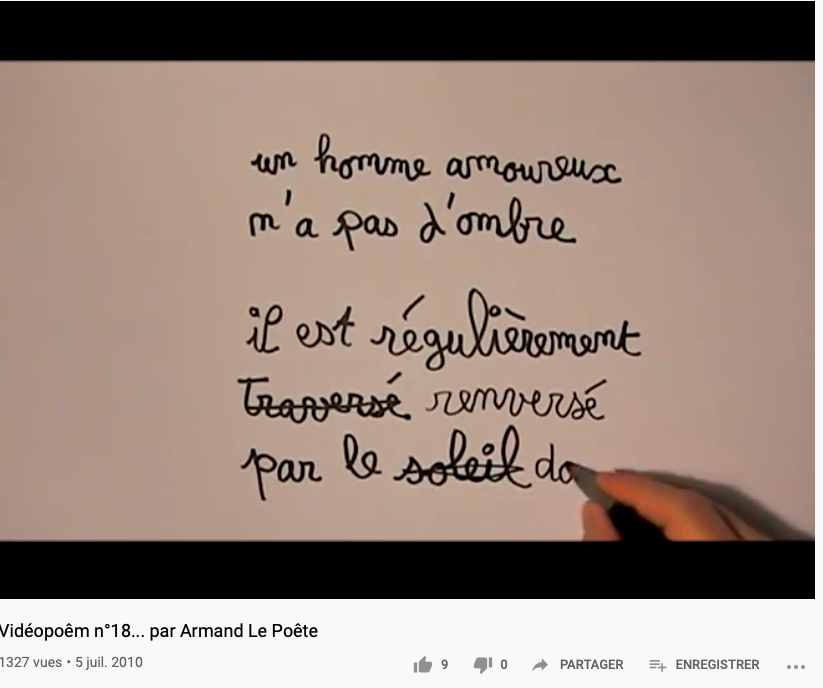
« Vidéopoêm n°18… par Armand Le Poête » par Patrick Dubost
Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.
Crédits : Armand Le Poête
Pourtant, il ne s’agit pas de captations brutes : les vidéos sont montées, et des jeux de vitesse et superpositions d’images font par endroits apparaître le texte en transparence avant qu’il ne soit écrit, ou, à l’inverse, créent des effets de simultanéité, la main apparaissant alors deux fois sur l’image, dont l’une en transparence comme repassant en accéléré ce qui a déjà été tracé, dans « Poême n°20 d’amour », précisément sur le mot « ENCORE ». Aux mouvements de la main traçante s’ajoutent enfin les animations en stop motion des menus objets déposés sur la feuille à la fin de chaque vidéo, qui viennent compléter, distordre, entrer en tension ou dialogue humoristique avec le texte inscrit. Dans un premier temps la candeur du poème d’amour joue sur les clichés liés à l’écriture manuscrite scolaire, appliquée, aux formes arrondies, et semble faire du médium vidéo un moyen de rendre la spontanéité du premier jet, confirmée par la maladresse, les erreurs, les ratures. Mais la dysorthographie et les ratures font dérailler la belle cursivité, et entrer l’idiosyncrasie, tout comme de l’indécidable, également dans la mesure où une tension s’installe entre l’écriture manuscrite et ce qui relève manifestement d’une écriture vidéo : s’il ne s’agit pas de captations en direct, cette dernière est particulièrement visible non seulement dans le choix du plan mais dans le travail de montage, superpositions, animations, accélérations et ralentis. Décrivant la scène d’ouverture de Van Gogh de Maurice Pialat, Vincent Amiel explique que le filmage tout particulier du geste de peindre y révèle une interrogation sur la « participation corporelle du cinéaste à sa propre création » :
La caméra, d’abord appliquée à cette main, la suit, la perd, la rattrape. Nous sommes sur un geste de peinture, puis peu à peu sur un geste de cinéaste : le cadrage, la mobilité de la caméra, le ralenti, le raccord, la désynchronisation, tout dit qu’il y a un cinéaste à l’œuvre (2013).
Si le réalisateur de la vidéo et le scripteur du texte écrit sont ici les mêmes, reste que ce sont bien deux écritures qui y sont à l’œuvre pour produire un objet éminemment intermédial.
Les vidéos de Giney Ayme ne sont pas nativement youtubéennes, l’artiste œuvrant depuis les années 2000 à la création et à la diffusion de vidéopoèmes via une collection de DVD (Incidences), et leur remédiatisation sur la chaîne participe essentiellement d’une volonté de remise en circulation de travaux difficilement accessibles. Cependant, leur éditorialisation autorise la publication d’un commentaire descriptif, éclairant la vidéo sous un jour nouveau, et donnant au passage au spectateur des indications quant à la manière de la regarder :
Il faut régler le son à fond car c’est de violence dont je parle ici, celle de la naissance du travail et de la forme de l’oubli. Celle qui sépare l’oral de l’écrit. Les œuvres, il faut les envoyer en l’air pour savoir le bruit qu’elles font en retombant. Donc le son est très important, comme si, tout seul il fabriquait l’image, sans artiste ni plume ! C’est là mon affection pour cette valeur ajoutée qui est le bruit du travail attelé au bruit de la penséeDescriptif de la vidéo « Plumerage », Giney Ayme, 15 janvier 2018.
↩︎.
Il en va de même pour les poèmes vidéo d’Armand le poète, dont la deuxième série n’est d’ailleurs pas diffusée sur YouTube mais exclusivement sur DVD montrés à l’occasion d’expositions. Leur comparaison avec des poèmes réalisés à l’aide de moyens spécifiquement numériques et pensés pour la diffusion sur le Web, en particulier YouTube, est à cet égard intéressante dans la mesure où elle met en évidence des écarts importants dans la manière d’envisager l’écriture (ou non-écriture) vidéo.
Dans son ouvrage sur l’art vidéo, Françoise Parfait rappelle que les pratiques historiques de vidéoperformance offrent une image vidéo qui « cadre le corps et le découpe, le réduit et le formate » (2001, 214), jusqu’à définir exactement son espace de mouvement. Le cadre tient alors lieu de scène, comme dans les « performances d’atelier » de Bruce Nauman, dont les actions s’inscrivent dans un cadre prédéfini, ou encore chez Vito Acconci : la vision rapprochée élimine le hors-champ et « fait de la kinésphère un monde réorganisé autour des limites du corps » (2001, 214). Hubert Besacier estime également que la vidéo permet de travailler sur la fragmentation de l’image corporelle, en particulier lorsque la « performance est conçue et réalisée uniquement pour la caméra », dans la mesure où cela conserve « au geste toute sa force, dans sa réalité et sa simplicité, tout en exerçant le contrôle en cours d’actionHubert Besacier, « Vidéo et performance », Communication prononcée lors du 2e VidéoArt Festival de Locarno, août 1981, reproduit dans Janig Bégoc, Nathalie Boulouch, Elvan Zabunyan (dir.) (2011, 175).↩︎. » Ce découpage des corps est à l’œuvre dans les vidéos précitées, où l’espace montré est entièrement occupé, jusqu’à se confondre, par celui de la page blanche sur laquelle la main inscrit. Mais dans d’autres cas le cadrage spécifique imposé par la fixité de la webcam dessine à son tour un espace prédéfini, où la place du corps est contrainte : les usages ont consacré le format de la talking head, lui-même emprunté au média télévisuel, cadrant la partie proférante du corps, la tête, d’où émane le son, la voix, le verbe. D’écriture vidéo il n’y a alors pour ainsi pas, l’autofilmage étant réduit à une fonction minimale d’enregistrement de l’action et le cadrage se révélant contraint. De nombreuses vidéoperformances, comme nous l’avons montré, reproduisent ce format. Mais lorsque la performance s’amuït ou lorsque le geste d’écriture est montré à l’image, alors c’est une autre partie du corps qui est isolée : au cours des années 2005-2010, le Web regorge de corps sans têtes, d’usagers vidéastes ou photographes souhaitant garder une forme d’anonymat – la pratique a ensuite cédé la place à une hyper présence des visages, selon une pensée de l’identité numérique qui s’est peu à peu substituée à la logique initiale de l’anonymat généralisé.
Les vidéopoèmes de Corinne Lovera Vitali ne révèlent ainsi à aucun moment le visage de l’autriceVoir la chaîne YouTube de l’autrice.↩︎. « Plusplusplus » présente un plan fixe, à hauteur d’un cahier ouvert posé à terre ou sur un lit, placé devant une femme assise, jambes écartées de part et d’autre du cahier, tronquée à la taille et aux cuisses, tenant un crayon à papier muni d’un tuteur. Muette, la vidéo ne donne à entendre que le grattement de la mine du crayon sur la page du cahier : comme chez Giney Ayme, le son de l’écriture se substitue au son de la voix. Le cadrage frontal donne à voir le cahier à l’envers, lisible uniquement par le scripteur. Un adaptateur type « Grippie », tuteur pour écrire utilisé chez les scripteurs atteints de dyspraxie ou pour l’apprentissage de l’écriture, est fixé au crayon avec difficulté, puis la scription commence, de quelques mots, vus à l’envers par le spectateur, et très difficilement lisibles de ce fait. Pendant l’écriture, le tuteur descend petit à petit, est remonté, mais redescend et finit par empêcher le tracé. L’écriture est ainsi non seulement difficile, hors des lignes, grossière et maladroite, mais empêchée par ce qui devrait la faciliter, aboutissant à un geste d’humeur (lâcher du crayon) et à un échec de l’entreprise. La vidéo est associée sur le site de l’autrice à un texte du même titre, daté du 3 août 2018 où les éléments mis en scène à l’écran se retrouvent :
comme j’écris un coup ici un coup dans mon cahier nommé « coco journaliste » je ne sais plus où j’en suis or si je suis juste ça m’arrive pendant quelques minutes quand je me dis « si je suis juste » je n’ai jamais su où j’en étais c’est si confusant la vie (2018).
Lui-même porté sur l’écriture, le texte montre une pensée déroulée par associations, une manière de flux de conscience, sans ponctuation, où l’acte d’écrire est considéré de façon sévère, comme une activité à la fois pénible et stupide :
de toute façon si je suis juste écrire m’a toujours urtiquée j’ai toujours trouvé que c’était profondément débilitant de devoir faire cette activité en ce qui me concerne et aussi tous mes contemporains je nous trouve tous débiles et suffisants et pauvres malades […] les seuls qui m’intéressent encore ce sont ceux qui ont été sérieux pas sérieux (Lovera Vitali 2018).
À l’écriture comme scription tutorée mais empêchée et rendue pénible précisément par le tuteur se superpose dans le texte le métier d’écrire, perçu comme débilitant, masquant une suffisance coupable. L’écriture y est dévalorisée au profit des « sérieux pas sérieux », l’écriture idiote, celle peut-être qui n’est précisément pas « tutorée » et laisse à la dyspraxie comme aux autres « dys- » (y compris la dysorthographie d’Armand le poète) la possibilité d’agir. Dès lors, le geste maladroit présenté dans la vidéo se situe aux antipodes du geste d’écrire tel que décrit par Michel Guérin, « en tous le geste noble, celui qui place la main dans la plus grande proximité du cerveau », produisant « ce dessin merveilleux et abstrait qui, de se supprimer comme tel, fait sens » (2011, 21).
L’opposition implicite entre ce qui serait un art d’écrire, ou de tracer, et une pratique se révélant laborieuse, est aussi explorée dans « Scarabocchio », autre vidéo très courte, sans voix, où un acte de scription est filmé.
« ‘scarabocchio’ - clv » par Corinne Lovera Vitali
Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.
Crédits : Corinne Lovera Vitali
Posé sur une surface de marbre, un bloc-notes avec des feuilles blanches apparaît dans le plan. Sur la première feuille, trois petites sculptures en pâte à modeler ou argile, de facture maladroite, sommaires, en équilibre. Le plan fixe offre au regard la feuille à l’envers. Filmée en gros plan, une main entreprend d’écrire au crayon à papier, mais repasse et entremêle les mots en un écheveau illisible, puis jette le crayon au bout d’une minute, laissant un gribouillage, sorte de monticule d’inscriptions enchevêtrées. Le seul son perceptible est le grattement de la mine du crayon sur la feuille : là encore, le son de l’écriture n’est pas le son de la voix. Activité machinale sans réflexion préalable, et dénuée de toute intention esthétique, le « gribouillage » désigné comme tel par le titre de la vidéo, relève du geste ordinaire, sans visée artistique, donnant lieu à une production éphémère, sans valeur. Sans propriété formelle spécifique, rappelle Jean-François Puff, il tient sa forme d’un « rapport surface/temps » (2011, 103), saisi par le filmage vidéo. Là encore, l’action identifiée comme scripturale ne produit pas de texte lisible, de signes à lire, mais un enchevêtrement de signes graphiques, trace d’un geste perçu comme d’écriture, qui se rapproche des imitations enfantines : « En la dessinant, en en mimant le geste, en manifestant son pur désir d’écrire, l’enfant nous présente une écriture in statu nascendi, une écriture libre » (2011, 103). La vidéo est aussi publiée sur le site, accompagnée d’un texte à teneur autobiographique, où l’énonciatrice relate une visite à un hypnothérapeuthe, et enclenche une réflexion sur la notion de « prise en charge » :
Lorsqu’on est pris en charge eh bien on est pris en charge que voulez-vous que je vous dise ? Vous voulez absolument qu’on devienne autonome et qu’on accepte de perdre son enfance puis qu’on accepte de perdre ses parents puis qu’on enfile l’insouciance comme une veste en lin et qu’on s’avance nonchalamment vers sa propre mort comme un sage situé dans l’Antiquité ou au Japon (Lovera Vitali 2019b).

Écrire à l’écran
Écrire à la main, c’est aussi, comme l’écrit Arnaud Maïsetti sur son blog, « dicter les lettres les unes après les autres, mais dans le silence de ce bruit mat que forment les touches appuyées vers le sol, s’entendre respirer à cette mesure, ou percevoir comme des pas qui vont vers soi » (2013). Ce sont précisément ces « bruits mats » et, parfois, la respiration du scripteur que certaines des captures vidéo de Corinne Lovera Vitali donnent à entendre dans plusieurs vidéopoèmes, où le filmage du geste de la main est remplacé par des performances d’écriture à l’écran. Écrire en régime numérique ne se résume cependant pas à taper sur un clavier, et implique un panel de gestes qui entrent dans le processus d’écriture, lié à la manipulation de l’outil et de ses logiciels : taper donc, mais aussi cliquer, cliquer-glisser, scroller, déplacer la souris ou le doigt sur le pavé ou l’écran tactile, etc. « Plutôt que la trace, c’est aujourd’hui le geste effectué sur la matière textuelle qui se trouve exploré et interrogé par la création numérique » (2007, 54). Si Alexandra Saemmer et Serge Bouchardon ont montré que cela implique l’action du « lect/acteurJean-Louis Weissberg cité par Philippe Bootz (2007).↩︎ », les vidéoperformances d’écriture donnent aussi à voir une panoplie de gestes de la main de l’auteur sur son texte en cours d’écriture.
« Mon clavier », de Corinne Lovera Vitali (2016), premier poème de la série numérique « C’est ma valise » diffusée sur le site Libr-critique entre 2016 et 2018, présente la capture vidéo d’un clavier à l’écran, mais ne donne pas à lire le texte qui s’écrit : des lettres tapées sur le clavier physique, lui-même invisible à l’écran, se colorent de jaune sur le clavier virtuel et chaque lettre émet un son identique signalant une « erreur ». Un texte est donc bien en train de s’écrire mais on ne sait pas où, ni si, il s’inscrit. Seul le geste effectué de taper est perceptible, et l’échec de l’inscription, soit l’inaboutissement de l’action entreprise. La vidéo en reste alors la seule trace, faisant, par l’enregistrement, accéder le geste ordinaire et l’échec de la production textuelle, au statut d’œuvre.
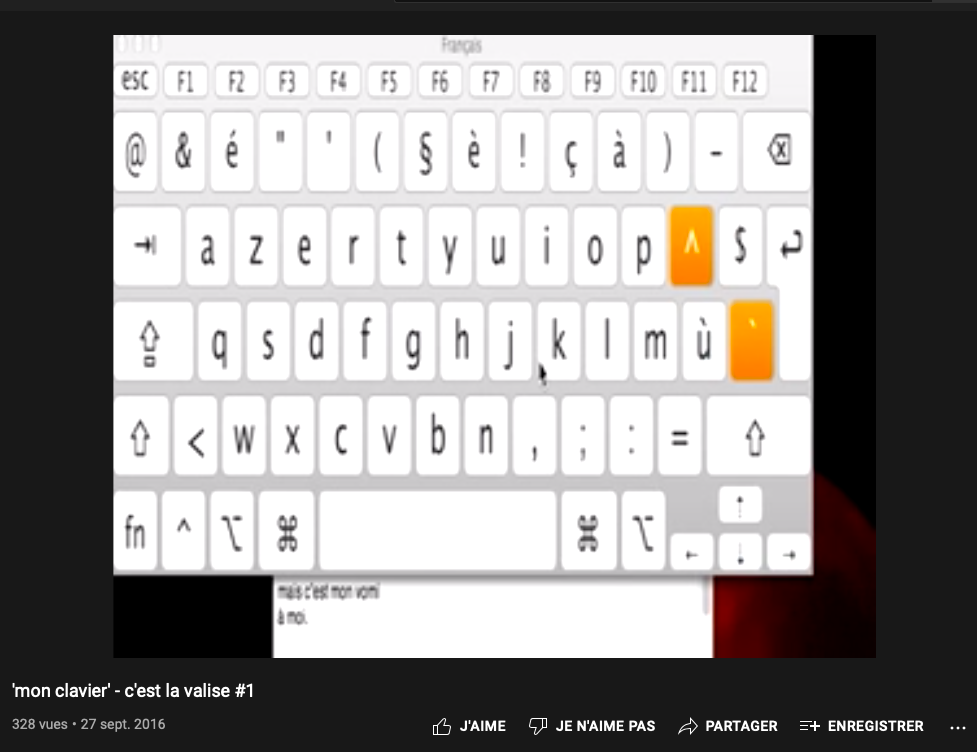
« Re ma vie » et « Auto » sont aussi issus de captures vidéo de gestes d’écritures à l’écran, où s’engage, dans des textes dits ou lus, une réflexion en actes sur l’écriture, entendue à la fois comme geste et comme acte de création. « Re ma vie » s’ouvre sur une page de traitement de texte (il s’agit du logiciel Pages, présent par défaut sur les Mac), où s’effectue, durant 10 minutes, l’écriture par copier-coller de bribes d’un texte déjà commencé dont la cohérence se perd peu à peu, ou, plutôt, dont le déroulé suit le cours et les évolutions d’une pensée : « je me suis concentrée quelques instants sur ma vie ». Cette première proposition, au passé composé, est censée appeler une confession, ou du moins un écrit de type autobiographique livrant les produits de la réflexion annoncée, mais le programme vacille aussitôt, la suite du texte s’écrivant précisément sous nos yeux de l’impossibilité de suivre un quelconque programme : « je ne dis pas que j’ai sauté à pieds joints je ne suis pas très sûre des appuis jointés je ne suis pas très sûre de mon équilibre je préfère de loin me tenir à l’écart comme il existe entre les bras puis celui du langage ». L’absence de ponctuation et le déroulé de l’écriture signale une improvisation, ou une semi-improvisation (les agencements de blocs déjà écrits et collés là peu à peu) rappelant un style à sauts et gambades, où le texte littéralement en mouvement s’écrit, puis recommence, se réécrit, se réagence, dans un équilibre constamment déséquilibré. Le texte, qui s’écrit alors en performance, revient sur son écriture, par le copier-coller qui le fait bégayer, reprendre, recommencer, mais aussi par son commentaire et l’aveu palinodique du mensonge réitéré qui préside à ses recommencements :
Je me suis concentrée mon œil cela m’est impossible suivre ma seule nature m’est possible et avoir naturellement une vision aussi rapide que le Z du fin moustachu à la suite de quoi au lieu de faire des effets de cape avec mon chapeau serré sous le menton n’en ayant pas plus que d’épée malgré mon habit noir je m’installe chez moi dans la nécessité qui m’est naturelle de prolonger ce Z qui ne peut certainement être qu’un commencement ce que bonne fille je fais chaque fois je fais durer le commencement je prolonge le zozottement de ma nature écartelée en commençant chaque fois par un mensonge de type je me suis concentrée quelques minutes etc.
S’incarnant métaphoriquement elle-même dans un geste d’écriture fameux, celui qu’effectue Zorro signant son action héroïque à la pointe de son épée, et dans sa lettre initiale qui est aussi la finale de l’alphabet, la concentration troublée par un déficit d’attention devient alors le point de départ d’une modalité de création en prolongement de, et non en lutte contre, quelque « déficit ». Prolonger « le zozottement de ma nature écartelée », revient alors, précisément, à ne pas s’en tenir au Z gravé, ce qui reviendrait aux « effets de cape », mais à poursuivre, abandonnant alors, la fixité de l’écrit imprimé pour la fluidité temporelle de la vidéo. Au bout de la quatrième minute, un nouveau commencement part de l’aveu : « sans m’être concentrée ». Le Z de Zorro, « reparti » à la fin du texte, est aussi alors l’éclair dans lequel apparaît la vie passée, la dernière lettre de l’alphabet que l’écriture tente de reparcourir dans l’autre sens, sans réussir à en saisir les « regrets » annoncés par le projet originel.
« Auto » filme partiellement, en plan rapproché pris de biais, l’écran d’un ordinateur où un logiciel de dictée vocale est en cours d’utilisation, comme le signale l’icône et le texte qui s’inscrit à vitesse bien plus rapide que l’écriture sur clavier ne le permet.
« ‘auto’ - clv » par Corinne Lovera Vitali
Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.
Crédits : Corinne Lovera Vitali
Partant d’un constat de panne d’ordinateur, « mon Mac a rendu l’âme », nouvelle entrave à l’écriture, le propos déploie là encore une réflexion sur l’écriture et ses moyens, son rapport incarné aux outils : « je dis : mon écriture vient de mon corps ». La performance du texte en cours d’élaboration passe ici par la voix, et sa mise en correspondance rêvée avec l’écrit promise par les outils logiciels, adaptés à l’écriture en « pensée véloce » de Corinne Lovera VitaliQui n’est pas sans rappeler le flux sarrautien. L’autrice des Tropismes est d’ailleurs citée à plusieurs par Corinne Lovera Vitali.↩︎, que les instruments traditionnels de scription mis à l’épreuve échouent à suivre, comme le montrent les vidéos d’échecs d’écriture précédemment commentées : « je ne sais plus quand ni comment ça a commencé la contre pèterie la con traction la psus qui s’est déshinibée dans ma bouche qui parle comme qui écrit et elle embrasse aussi avec sa manière à elle de tout téter » (2019a, 21). Si l’écriture vient du corps, « elle dépend fortement de APPLE », et des conditions pratiques et matérielles dans lesquelles le corps écrit (Candel et Gomez-Mejia 2010). Le point de départ du texte, un empêchement d’écrire dû à une panne, se poursuit en réalité dans la suite de la vidéo : le texte qui s’inscrit sur l’écran ne correspond qu’imparfaitement au contenu des énoncés proférés par la voix qui l’accompagne sur la piste audio du vidéopoème. Le propos glisse alors vers l’évocation des « archéologistes » censés récupérer les données enfouies dans le disque dur, que l’autrice invite à aller fouiller plutôt dans ses documents administratifs pour trouver les raisons profondes de l’empêchement : « vous comprendrez pourquoi ça migre le travail, vous comprendrez pourquoi les majuscules tombent », que « l’écriture en vieillissant perd ses habits ». L’empêchement physique, dyspraxique et dyslexique, d’écrire, se lie, nous révèle l’énumération des documents, à un deuil traumatique : « elle regarde […] les mots utilisés pour parler des écritures : ils sonnent maintenant comme dans le temps sonnaient les mots pour transmettre ses condoléances je n’y comprenais rien ». Partant, « tout geste compte chaque clic est compté ». L’œuvre sera un « écrit pas écrit » qui rend la pensée véloce sans l’engoncer des « habits » empesés d’une mise en page, celle-ci devenant, selon une métaphore usuelle ici associée à une expérience intimement corporelle, un tombeau que l’autrice refuse. Évoquant dans un autre texte son passé de correctrice de manuscrits, l’autrice accuse les écrivains : « Ces choses fluides comme la vie ils en ont fait des choses mortes » (2013), la mise en mots équivalant à une mise en tombe.
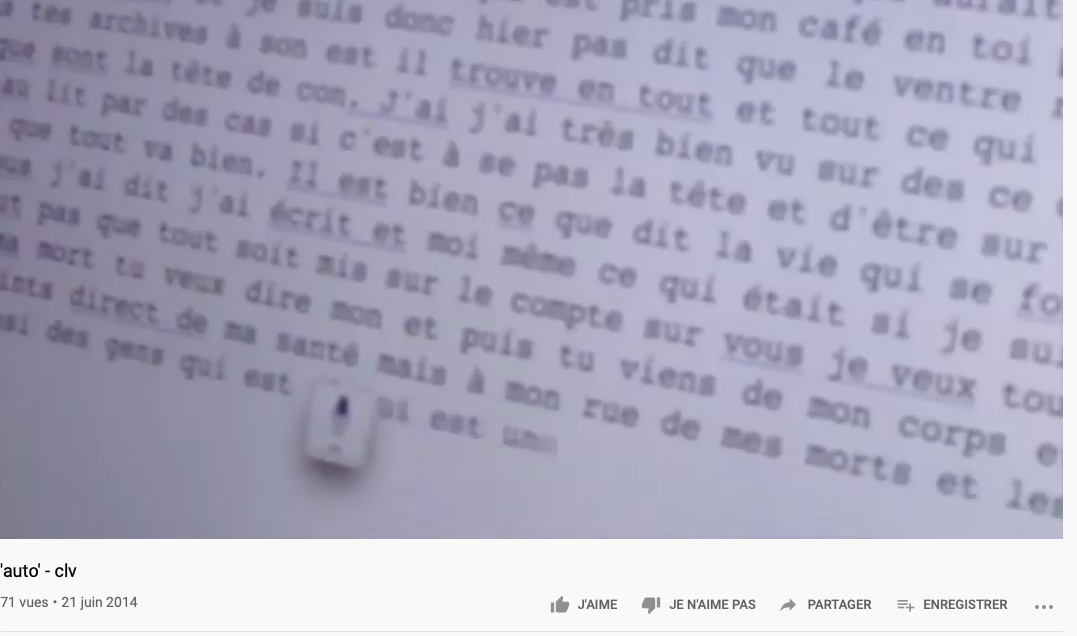
Des « choses fluides », c’est littéralement ce que donne à voir le vidéopoème « ‘ponc, tuer vs easy cummings’ - avec Fernand Fernandez - c’est la valise #4 ». Écrit à partir, d’une part, d’un lapsus (ponctuer devenu « ponc.tuer »), d’autre part de la formule d’un personnage de série télévisée, Mickey Donovan, qui dans un épisode décrit la possibilité de faire du Cummings « facile » (« easy cummings : no capitals no periods any of that shit just papapapa« Cummings facile : pas de majuscules, pas de points, aucune de ces conneries, juste papapapa » (notre traduction).↩︎ »), un texte tapuscrit, lisible dans son intégralité sur la partie gauche de l’écran, revient « toujours sur la difficulté à dire / écrire », ici centré sur le refus revendiqué de la ponctuation. Le poème lettre, adressé à un « cher petit text,e », explique l’arrêt de cet usage, « parce que / ces signes sans son ces freins ces émotions imposées / ces sous-titres immobiles ces espèces d’indications d’idascalies » : « & c’est déjà assez EMMERDANT comme ça / heureusement qu’on parle & / il y a les voix les accents les erreurs lapsus tout il y a / toutes les dites dysfonctions / heureusement qu’on peut faire papapapapa ». Comme dans les vidéopoèmes précédents, la pratique d’écriture est considérée comme non seulement difficile, mais exaspérante, et le non-art poétique présenté par les vidéos continue de s’y (des-)écrire, valorisant l’accident, l’erreur, le ratage et les « dysfonctions » comme autant de moyens créatifs au plus près de l’expression. Sur la partie gauche de l’écran en splitscreen, la vidéo d’une performance que l’on pourrait qualifier d’écriture soufflée, de Fernand Fernandez, montre une « voix d’encre » à l’œuvre qui se passe de l’écriture scripturale pour inventer une forme autre, visuelle et phonétique. Sur une surface bleue recouverte d’un rectangle de farine, de l’encre bleue semble soufflée goutte-à-goutte d’une longue pipette, formant d’abord une sorte de dripping, pour venir se déposer de façon linéaire, former des amas dont la succession et la mise en espace mime celle du poème versifié. La bande-son fait entendre une parole inarticulée en borborygmes, poésie phonétique dont les éclats coïncident avec le dépôt des signes sur la page-farine, surface qui mime un espace langagier avec des éléments concrets et non signifiants : une image de poème. Ce que produit l’appareil phonatoire ici n’est pas articulé, l’écriture qui en émane n’est pas une écriture de mots, mais, dans la confrontation à laquelle invite le rapprochement du splitscreen, résonne avec ce que l’autrice désigne comme « nos giclettes nos pécoles quoi quoi d’autre sérieux quoi d’autres ». Le seul substitut possible de parole orale serait la giclée d’encre soufflée, image dérisoire, miroir ironique d’une écriture mue par une recherche vaine :
Quand je parle, les mots m’imposent des règles phonétiques et quand je les prononce, ils deviennent des corps sonores, vibrations dans l’air. Il ne s’agit pas, dans ce cas, de la linéarité spécifique du geste d’écrire dont j’ai parlé. Il n’est donc pas exact de dire que l’écriture est une annotation d’une langue parlée. […]. Les mots se dressent contre l’écriture d’une façon différente de celle qu’ils opposent à l’oralité (Flusser 2014, 49).
La vidéo autorise ainsi la confrontation mais aussi l’inclusion de plusieurs formes d’écritures, dans une écriture élargie, où l’éphémère et l’instable l’emportent sur la trace (la farine et l’encre finiront mélangées et dispersées).

« J’ai un gros problème avec l’autorité je suis experte de rien » (2019a). Ce que Corinne Lovera Vitali nomme parfois ses « rikiki youtube écrits pas écritsCorinne Lovera Vitali, sur son site (2018).↩︎ » sont ainsi autant d’œuvres sur et avec des possibilités d’écritures, des écritures avortées qui produisent des poèmes par le biais de l’écriture tierce que représente alors la vidéo. L’exploration en vidéo des gestes d’écriture dans leurs variétés mais aussi leurs échecs apparents, leurs ratés, produit, chez Corinne Lovera Vitali mais aussi chez d’autres comme Armand le poête et son exploration de la dysorthographie, des déplacements dans l’appréhension d’un geste à la fois ordinaire et créatif. Si dans les œuvres concernées l’écriture vidéo est réduite à son degré minimal avec le choix du plan fixe, c’est que la vidéo y est moins appréhendée comme un art que comme un dispositif de capture de performances d’écriture où celle-ci se manifeste dans sa physicalité sans que le corps soit systématiquement mis en scène ou visible à l’image. Filmer l’écriture dans ses ratages, dans le flux de sa progression, c’est l’appréhender dans sa performativité et l’interroger dans cette dimension même. Le procédé de la capture vidéo d’une écriture d’écran ou d’une écriture manuscrite et sa publication sur une plateforme dédiée à l’image produit un effet réflexif : d’une part en ce que toute photographie de texte, ou capture d’écran, attire l’attention sur sa visualité, et sur la matérialité du support, fût-il déjà un écran ; d’autre part en ce que la vidéo introduit le lecteur dans un espace-temps auquel il n’a d’ordinaire pas accès : au processus d’écriture. Filmer son propre geste d’écriture ou capturer ses échecs produit ainsi nécessairement une forme de métadiscours, souvent relayé et précisé par le propos, mais aussi par le dispositif même. Dans le domaine de la littérature numérique, la capture vidéo est généralement utilisée de façon à reproduire un des possibles « transitoires observables », dans les poèmes numériques de Philippe Bootz ou Serge Bouchardon par exemple, visibles sur leurs chaînes YouTube respectives comme autant d’archives, traces de performance d’écri/lecture requérant l’interactivité. C’est aussi le principe des vidéos de gaming, en particulier du let’s play, parmi les genres dominants sur YouTube, où le vidéaste « est à la fois joueur, commentateur et réalisateur » (Urbas 2016, 93‑114) et où s’associent « capture d’une partie jouée au commentaire du vidéaste enregistré à la volée ». Dans ces genres, « la continuité de la vidéo rend compte du flux de l’expérience du joueur, dépourvue de montage a posteriori » (2016, 93‑114). Les captures vidéo de performances d’écriture de Corinne Lovera Vitali, sans se référer en aucune façon au monde du jeu vidéo, rejoignent cependant cette visée, proposant des écritures en performance où le geste même d’écrire est chaque fois réinterrogé, reformulé, comme expérience pratique et physique, ergonomique et psychique. La performance d’écriture relève ainsi nous semble-t-il d’une esthétique des gestes ordinaires. Publiés pour certains dans une rubrique du site intitulée « C’est la vie », titre qui sonne comme un constat désabusé que l’on énonce en haussant les épaules, expression populaire et banale d’une sorte de fatalité non tragique, ils proposent une « imprésentation », selon l’expression de Barbara Formis, incluant « l’idée d’imprésentable, entendue comme quelque chose qu’il ne faudrait pas montrer et qui demeure dans la sphère de l’intime […] une modalité d’exposition et d’exploitation, une façon de montrer et de vivre l’ordinaire sans le transfigurer ou le mettre sur un piédestal » (2010, 120), à l’opposé du « geste représenté », qui, lui, fait du geste un moyen d’expression d’une idée ou d’une émotion.
Les gestes d’écrire se chargent ainsi, dans la pluralité de leur mise en œuvre, de valeurs diverses, qui engagent dans tous les cas ici envisagés une mise en relation repensée entre le corps du poète et son écriture, à l’opposé des régimes de visibilité médiatiques de l’écrivain au travail.
Contenus additionnels
« Đà Lạt, filmer des phrases (2) » par Anh Mat
Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.
Crédits : Anh Mat
« tendresse de béton | gracia bejjani » par Gracia Bejjani
Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.
Crédits : Gracia Bejjani
« Spectacle! » par Milene Tournier
Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.
Crédits : Milene Tournier
« ‘auto’ - clv » par Corinne Lovera Vitali
Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.
Crédits : Corinne Lovera Vitali
« ‘scarabocchio’ - clv » par Corinne Lovera Vitali
Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.
Crédits : Corinne Lovera Vitali
« Vidéopoêm n°18… par Armand Le Poête » par Patrick Dubost
Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.
Crédits : Armand Le Poête