2 [II] Lisibilité [L’illisibilité] comme paradoxe et paradigme technologique et théâtral
Dans cette partie ? [,] je vais approfondir les enjeux soulevés par lisibilité [l’illisibilité] du texte transcrit. Bien que ces [ce] textes [texte] soient [soit] mis en forme et présenté de manière académique, son contenu serait en grande partie illisible en l’absence de corrections complémentaires. Je pense qu’en [qu’un] lecteur non averti ne comprendrait pas le texte, ce qui le rend partiellement hermétique et ésotérique, car il est nécessaire d’avoir une clé [clef] de lecture, d’être initié aux enjeux du texte pour mieux le comprendre ? [.] Cependant, en même temps [en mettant] à la place dans [d’un] spectateur non averti, je peux imaginer plusieurs potentiels nouveaux tiré [tirés] de ce texte.
Design [Dans un] première ton [temps], je pense que c’est ex [ce texte] transcrit, confronte le lecteur à une forme de folie textuel [textuelle] qui permet d’apporter un regard complémentaire sur la technologie.
Dans un 2nd [deuxième] temps, cette folie textuelle mais [me] plus [pousse] à explorer des potentiels théâtraux, à la fois tragiques et comiques. Enfants [Enfin] dans un 3e [troisième] temps, je voudrais [verrai] commencer [comment ce] texte transcrit me permet de renouer avec des gestes performatives [performatifs,] à la fois esthétiques et politiques.
Ah. [A.] Lisibilité [L’illisibilité], une folie textuelle et technologique ?
Ce qui apparaît d’abord, ce [c’est] que mon texte ne se livre pas à l’exercice d’une lecture fluide et rationnel [rationnelle,] comme on pourrait le dire dans romans [d’un roman] aux [ou] données [d’un essai]. La ponctuation est anarchique et le texte est plus ratchet [haché] que le discours que je dis à la machine. C’est pour cela que j’estime que le texte est relativement illisible, difficilement compréhensible, surtout si on supprime les corrections entre crochets.
Cette configuration ou [où] je dicte mon texte en [à une] machine et ou [où] je le corrige ensuite à [a] quelque chose de quiche tesque [« quichottesque »]. En effet, en parlant à une machine que [qui] ne répondent [me répond] pas, et en cherchant [à] la corriger, j’ai [je] m’engage dans une bataille gratuite est [et] folle, comme si je me battais contre les Moulins à vent pour faire vivre en [un] idéal chevaleresque. [,] à l’exception que cette fois-ci je me bats pour faire vivre mes idées. La correction entre crochets est un peu comparable à la prise des consciences finales des [de conscience finale de] Don Quichotte, qui, moran, est ton nom [qui meurt en retournant] à la raison. C’est pour ça que je mets au 2nd [second] plan les corrections, car donner uniquement une version corrigée de ce mémoire, ce serait faire mourir mes idées et les abus, j’ai [abjurer].
C’est pour cela que je peux dire que même si la forme de ce mémoire n’est pas celle du [d’un] roman ou dans [d’un] les [essai,] d’une part, ce mémoire est partiellement corrigé pour en faciliter la lecture, et d’autre part, se nourrit Jin et s’informe [son origine et ça forme] ont quelque chose de romanesque.
Ça t [Cette] lisibilité [illisibilité] est d’abord le reflet de ma difficulté à comprendre et à saisir l’objet de ma recherche. C’est la matérialisation esthétique de cette difficulté. Je dirais aussi que la culpabilité de cette illisibilité revienne [revient] à la fois à moi et à la machine. En effet, cette illisibilité et [est] en première [premier] lieu la conséquence de ma mauvaise prononciation, d’une [d’un] usage dévié de la machine, mais aussi de défauts techniques de la machine, d’une faiblesse à saisir ce qui a [est] dit trop vite ou [dit] différemment. Nous sommes ainsi deux à contribuer à cette lisibilité textuelle.
C’est aussi une lisibilité [illisibilité] que [qui] c’est [se] rapproche de celle du codage, auquel j’ai pu un peu m’essayer cette année, qui est en [un] alphabet constitué de symboles reconnaissables mais qui demeure dans son ensemble incompréhensible si on ne [n’en] connaît pas la clé de lecture.
C’est un peu le cadre [cas] de mon mémoire qui tend parfois [à] se rapprocher de cette incompréhension. C’est en [une] incompréhension qui a aussi souvent été la mienne devant des textes traitant de manière approfondie de la technologie, des algorithmes qui dépasse [dépassent] parfois mes capacités d’entendement en raison de leur complexité et de leur caractère énigmatique.
Je peux aussi dire qu’elle [que] lisibilité [l’illisibilité] de [du] texte et [est] renforcer [renforcée] parce qu’il transcrit bouge dans le temps et l’espace. C’est par exemple le cas lorsque j’essaie [je cite] Tiffany Sama [Tiphaine Samoyault] dans mon introduction, la citation est altérée par la transcription vocale et on se retrouve alors dans [l’Ohio] : « La traduction me paraît être en l’Ohio ou pour essayer penser la procréation » au lieu de « La traduction me paraît être un lieu où pourrait se penser la procréation ». Ici, le top des cités [plutôt que de citer] « un lieu » en défini [indéfini] et conceptuel comme le fait le texte source, le transcripteur vocal, choisit d’ancrer géographiquement la réflexion sur la traduction dans son [un] espace précis, l’État de Rio [l’Ohio] aux États-UnisEt encore une fois, on est tout de suite rapportés vers Rio de Janeiro, au Brésil. Ce qui pourrait donner une autre façon de regarder le même passage, renvoyant cette fois-ci à mon histoire personnelle ou à l’histoire de la « découverte » de mon pays.↩︎.
Je dois admettre que je [ne] connais pas grand-chose sur le rigo [l’Ohio], mais cette modification du discours place pendant [cependant] mon discours dans un univers américain, anglo-saxon qui n’est pas celui du texte source. L’état de Laura Yo [l’Ohio] m’évoque [aussi l’imaginaire de] la conquête de l’Ouest, donc [de la] colonisation ?Je remarque qu’en insérant un point d’interrogation, absent du discours originel, la machine met en doute l’existence de la colonisation dans l’histoire des États-Unis, de l’Ouest en général pensé comme un espace à conquérir selon une vision eurocentrée, comme si elle prenait un certain parti pris sur l’histoire.↩︎ [Ø] qui a fondé les États-Unis et peut être en cela les traces dans [d’une] histoire violente, ce que [qui] j’écoute? [recoupe] paradoxalement et transversalement la thématique du livre en question, comme c’est [si] de nouveaux sans [sens], pouvait [pouvaient] surgir de se hâter [cette] lisibilité [illisibilité]. C’est surprenant de voir que la transcription a aussi angliciser [anglicisé] le prénom de l’auteur [l’autrice,] qui passe de Tiphaine à Tiffany, ce qui confère par petites touches une forme de cohérence paradoxale [à] ce texte. L’opération de retranscription déplace non seulement le [les] lieu [lieux], mais aussi le temps. En effet, la machine change souvent les temps verbaux, notamment les temps de [du] passer [passé] qu’elle retranscrit au présent, par exemple, lorsque jeudi [je dis] « Il s’est agi » dans l’introduction, elle remplace par « ici, il s’agit ». Référencie [On repère aussi] une forme d’actualisation de mon discours, d’une [d’un] approche [rapprochement] qui brise la mise à distance induite par le passé. Cette idée est renforcée par l’ajout de déictique « ici », dans [dont] le sens locative [locatif] renvoie à une immédiateté, une instantanéité. C’est la merde [Cela me donne l’impression] que la machine est plus affirmative que moi et je reviendrai sur cette idée plus tard dans les mémoires [le mémoire].
De même, les participes passés qui se termine [terminent] en « é » comme passer « passé » son changer [sont changés] à l’infinitif se [ce] opérant [qui rend] la phrase intemporelle et générale puisqu’elle ne peut [n’est plus] à ancrer [ancrée] dans une temporalité défini [définie].
Lisibilité [l’illisibilité] bruit [brouille] aussi les distinctions académiques et la pureté du texte, je l’ai déjà dit en partie et j’y reviendrai. La transcription mais [met] en effet, on avance [en avant] des dimensions ans soupçonné [insoupçonnées] comme le spirituel, le théâtral, le poétique, l’autobiographique [etc.]. Aussi, la transcription a juste [ajoute,] modifie, mais elle retire parfois des éléments, elle se montre plus laconique que moi, notamment dans la partie où Jean Provise [j’improvise] sur Bruxelles ou [où] la machine place beaucoup de points dans mon discours.
J’associe cette lisibilité [illisibilité] à une manifestation de folie textuelle. Car ce texte se présente d’abord sur [sous] la forme du [d’un] monologue, reflet d’une forme de solitude de la parole. C’est ensuite on [un] texte à grammatical [agrammatical], plein d’erreurs, incohérent et qui divague.
Ces deux caractéristiques formelles se rapproche [rapprochent] de certaines manifestations cliniques de la folie ou plutôt de la Pathologisation de la folie comme on a pu le faire au dix-neuvième siècle notamment. Le texte transcrit et [est] texte névrosé, excessive [excessif], déréglé, fièvre [fiévreux,] halluciné, délirant et je pense que sa [ça] place le lecteur/spectateur dans la position de le juger comme un texte fouJe m’inspire un peu des lectures de Rimbaud et de Laforgue que fait dans sa thèse Renaud Lejosne-Guigon (2017).↩︎. Il m’apparaît en tout cas à mes yeux au moins comme un texte monomaniaque, qui sait [s’est] construire [construit] sur des obsessions disparaître [disparates] entre lesquelles l’étude à [a] créer [recréé] des liens. Ce rapport privilégiés [privilégié] qu’entretient mon texte avec la folie est à la fois un paradigme spécifique de réception, mais aussi de création, et c’est peut-être là une nouvelle manière de créer la folie, de la représenter sans recourir à des représentations pathologisant te [pathologisantes] où à des méthodes de « production », de la folie, on cherche [en cherchant] à s’halluciner par les drogues au parc [ou par] des états extrêmes, par exemple.
Le fait que ce texte soit fût [fou]Une nouvelle fois, le texte illustre cette folie, en redoublant le subjonctif « soit fût », qui est le mode de l’irréel, du doute, de l’impossible, du souhait.↩︎ me ramène à les comparer à Hamlet qui illustre bien les paradoxes, les ambivalences de la folie. Hamlet simule la folie, parle trop, [est] considéré alors par les autres personnages comme un fou, un marginal qui n’est pas pris au sérieux et qui est discrédité, mais pour les spectateurs, c’est le [ce] moment de folie il est [illustre] au contraire un moment de lucidité, de vérité, car Hamlet est le seul vois [à voir] vraiment les choses. Quand [Car] Hamlet, comme il l’annonce dans le premier acte, choisit délibérément de fendre [feindre] la folie : chance. Ciao. Tu peux te atque disposition. « I perchance hereafter shall think meet/ To put an antic disposition on (I., v. 179-180)Car désormais peut-être je trouverai bon/ D’affecter une humeur bouffonne » (Shakespeare et al. 2008)↩︎ ».
J’ai [Je] trouve que cette ambivalence de la folie réjouit [rejoint] ce que dit Derrida dans « cogito et histoire de la folie » (Derrida 2009) où il souligne que la folie est une forme du « logos », une de ces [ses] actualisations de [et] noms [non] sont [son] exact contraire. Le non-sens apparent de mon texte se veut être ainsi non pas une absence de sens, mais une autre manière de penser le son [sens].
En effet, la folie du texte me permet de sortir des règles, de parler sans penser, sans me justifier, sans surveiller la correction grammaticale alors que c’est souvent ce qui me bloque quand je dois écrire. Car j’hésite, c’est [si] tellement [tel mot] s’inscrit [s’écrit] avec un ou deux à elle « l », en 2 ème [un ou deux « m »]. Aussi à l’écrit, j’y [je] suis souvent plus redondant car je m’explique trop alors que le rythme de la machine mais plus [me pousse] à être concis et efficace dans ce que j’ai dit [je dit].
La machine m’enlèvent [m’enlève] emploi [un poids] quant à la pertinence, à la justesse éventuelle de mon discours, puisqu’elle est réactive non pas à ce qui est dit, mais comment s’est [c’est] dit, ce qui déplace mon attention et me soulage d’une forme d’autocensure ? [.] Je pense que ma tendance à la Sour Explication [sur-explicitation] de mes intentions est en particulier sur elle [partie culturelle], car le portugais brésilien est plus prolixe que le français, ce qu’on peut constater dans certains articles du code pénal où la version brésilienne énumère tous les cas possibles, tandis que la version française est plus concise (Orsoni 2001). En tout cas, la machine [me] permet de réduire considérablement cette tendance.
Cet espace de non-conformité grammaticale, de folie textuelle ouvre aussi pour le lecteur des voix [voies] imaginaires possibles. Ce discours pourrait être celui de entière [d’un tiers] qui, ne soit ni la machine ni moi, mais entière [un tiers] hybride, on ma tête c’est un fou [un mathématicien fou], une artiste maniac [maniaque,] un ingénieur métaphysique. Après avoir étudié les différents enjeux de la folie textuelle, cette dernière idée que suggère un possible fictionnel derrière ce texte à visée pourtant académique, où la fiction n’a habituellement pas vraiment sa place, mais [me] par [porte] ainsi à analysé [analyser] les potentiels teatro [théâtraux] sur les vies [soulevés] par ce texte transcrit.
Je peux déjà dire qu’en intégrer [qu’intégrer] la folie textuelle de sens [au sein] de mon discours brise l’isolement auquel les manifestations de la folie ont souvent été confiné [confinées]. C’est ce que retrace Michel Foucault dans l’introduction de l’histoire de la folie à l’âge classique [Histoire de la folie à l’âge classique]. Si spatialement la folie s’est vu exclu et Internet [vue exclue et internée], elle demeure un objet qui fascine et qui a occupé le centre des débats scientifiques, médicaux, mais aussi dans la culture. La figure du fou a notamment été centrale au théâtre, en tant que détenteur d’une vérité paradoxale, mais lassant [menaçante], qui tourne en dérision et trompe le monde (Foucault 2007). Ces potentiels teatro [théâtraux] seront explorés dans la partie qui suit.
B. Pourtant, ciel teatro de la démarche [Potentiels théâtraux de la démarche]
Après avoir étudié le lien [les liens] existant entre lisibilité [l’illisibilité] apparente de ce texte transcrit et la folie, je vais à présent explorer les potentiels théâtraux de cette démarche. Mon mémoire sanskrit [s’inscrit] d’abord dans la recherche de réactivation de Lyon [du lien] entre théâtre et technologie. Théâtre et technologie s’inspire [s’inspirent] en effet suivant [souvent] long [l’un] de l’autre. Je peux citer deux exemples de ce lien entre théâtre et technologie qui m’ont beaucoup marqué car on imagine facilement comment la technologie peut inspirer le théâtre, notamment en ce qui concerne la scénographie, mais l’inverse peut aussi se vérifier puisque le théâtre peut inspirer la technologie en retour. Par exemple, c’est au théâtre que le terme « robot » a été utilisé pour la première fois sous la plume de drama Tour [du dramaturge] tchèque Karel Čapek dans sa pièce de théâtre de science-fiction RUR Resûmes [Rossum’s] Universal Robots. Le terme a été inventé par son frère Joseph Québec [Josef Čapek], à partir du mot tchèque obota « robota » qui signifie travail ou sauvage [servage]. Publié en 1920, Rossens [Rossum’s] Universal Robots est une comédie utopiste en 3 actes et en [un] prologue qui raconte l’histoire de reçu [Rossum], on [un] savant qui en vend ton subsistance [invente une substance] lui permettant de créer en [un] robot anthropomorpheRéflexion reprise à mon mémoire de M1 « Théâtre et Technologie :l’artificialité comme protagoniste et l’imagination artificielle », université Paris 8, 2020, p. 13.↩︎.
De même, c’est au théâtre que le concept de « post-vérité » a été pour la première fois utiliser [utilisé] et mobiliser [mobilisé] pas le dramaturge serbo-américain Steve et Stich [Steve Tesich], qui avait fourché [forgé] ces mots [ce mot] pour décrire la défiance à l’égard de la vérité suite à l’affaire du Watergate.
We are rapidly becoming prototypes of a people that totalitarian monsters could only draw about in their dreams. All the dictators up to now have had to work hard at suppressing the truth. We, by our actions, are saying that this is no longer necessary, that we have acquired a spiritual mechanism that can The news is truth of any significance. In a very fundamental way, we as a free people, have freely decided that we want to live in symbols truth world« We are rapidly becoming prototypes of a people that totalitarian monsters could only drool about in their dreams. All the dictators up to now have had to work hard at suppressing the truth. We, by our actions, are saying that this is no longer necessary, that we have acquired a spiritual mechanism that can denude truth of any significance. In a very fundamental way we, as a free people, have freely decided that we want to live in some post- truth world. » (Kreitner 2016)↩︎.
Mon projet s’inscrit à l’intersection de ces deux tensions en cherchant à interroger la technologie par le biais du théâtre, et des réponses [de repenser] le théâtre sous l’angle de la technologie.
Même si ces liens sont forts et historiques, il est intéressant de remarquer qu’en l’occurrence le pluriel teatro [« théâtraux »] est presque systématiquement transcrit par théâtre [teatro], sur quelle équivalence sonore ? [ce qui est l’équivalent sonore.] Je me demande pourquoi la machine comment ? [commet] une erreur de retranscription alors que ce terme est commun et que je pense que je le prononce bien. Ça me donne l’impression que ce logiciel refuse de reconnaître ses potentiels dramaturgiques, ou que le théâtre représente pour lui une langue qui n’est pas la sienne, car [teatro] est le mot employé dans des nombreuses autres langues ******* [latines,] mais pas le français.
En lisant Le réel à l’épreuve des technologies, j’ai découvert le terme de Médiator, J. [« médiaturgie »]. C’est à dire en [un] dispositif théâtral dans lequel les médias, les outils en [ont une] importance dramaturgique et ou [où] les anciennes formes théâtrales sont dynamisés [redynamisées] par les nouvelles technologies notamment« Ce terme fait référence à une attention particulière accordée aux méthodes de composition dans les œuvres médiatiques qui, j’ose l’espérer, suggèrera de nouveaux moyens critiques permettant de les comprendre et d’écrire à leur sujet. Dans le contexte actuel, je me suis écartée de l’usage familier du mot “dramaturgie" en raison de ses liens historiques avec le théâtre, lui préférant celui de”médiaturgie”, lequel place les médias au centre de l’étude, quoique j’aie vivement conscience de la tension existante entre ces deux termes. » (Féral et Perrot 2013, 15)↩︎. [C’est un] Concept qui, je trouve, décrit bien mon intention dans ses mémoires [ce mémoire] de recherche création. C’est un [à] nouveau amusant de voir comment la machine comprend la médiature J [médiaturgie], qu’elle a traduit par [« Médiator J. »] ce qui me fait penser à la fois à une vision hollywoodienne de la machine surpuissante venons [venant au] secours de l’homme, ou nomination [le menaçant], par exemple Terminator, mais aussi à l’affaire du médiateur [Mediator], dont le scandale dans la presse avait mis en lumière les effets secondaires nocifs de ce médicament ? [.] C’est peut-être là une mise en garde de la machine à ne pas utiliser un concept sans en connaître les origines.
Je vais à présent approfondir les relations possibles entre ce travail et l’univers théâtral.
Tout d’abord. Je peux dire que le fait delarey ? [de narrer,] de raconter à soi et à la machine tout le discours de [du] mémoire approche [rapproche] cette modalité particulière de répétition de celle de l’acteur qui révise son texte pour le mémoriser. De même le texte produit ensemble [ressemble] formalmente [formellement] à un monologue, ce qui renforce sa dimension théâtrale. Parents jeu du contraire [Par un jeu de contraires], la méthode de composition de ce mémoire semble parodier celle du théâtre : C’est [ce] discours elle [est] dit pour être écrit, alors qu’en général le texte théâtral et [est] écrit pour être dit. L’espace-écran de l’ordinateur se révèle lui aussi dramaturgique. On changer en [En changeant] mon discours ? [,] la magie [machine] sort de la passivité. C’est [Cet] écran noir qui s’allume je peux le comparer à une scène qui c’est lumineux [s’illumine]. Par la médiation de l’écran, la limite entre acteurs [acteur] et spectateurs [spectateurs] se fait de plus en plus flux des fluides [floue et fluide]. En effet, je suis à la fois acteur et spectateur de mon propre discours, car la machine me fait penser, il me faire [et me fait] rire souvent. C’est un moyen pour briser ces 4e [ce quatrième] mur qui sépare le spectateur et l’acteur. Cette atténuation de la distance entre acteurs et spectateurs nous [acteur et spectateur me] fait penser à certains personnages de Brecht qui sont volontairement moins définis pour porter le spectateur à s’investir davantage, à réfléchir, à participer à l’épaisseur de personnage. C’est un peu pareil pour moi, la machine complète des passes [dépasse,] contrat dit [contredit] mon discours, tout en l’observant. Inversement, je suis spectateur de ce que dit la machine et je cherche à la comprendre. Ces éléments restent joignent [rejoignent] mon idée de fin de ma [M1] où je voulais réaliser un algorithme créateur.
Par ailleurs, si je m’adresse actuellement [à] une machine qui reste muette face à ce que je dis ? [,] cette machine n’en demeure pas moins dramaturge. En effet, elle modifie mon texte, abordé [apporte des] nuances, des complexités, des absurdités qui ont un fort potentiel théâtral.
Quand j’ai eu cette idée de [mémoire], mon désir était celui de co-construire cette [ce] [mémoire] de recherche-création avec une machine. Puisque je ne pouvait [pouvais] pas « faire créer » intégralement ses [ce] discours par la machine, j’ai voulu diminuer mon emprise sur la création. On écrivain [En écrivant] « faire créer », je m’aperçois que cette alliance du mot [de mots] résume assez bien ma démarche actuelle. Grâce à ce travail, j’ai vu que le fait de confier certaines tâches à la machine me permettre [permet] d’en développer d’autres. L’absence de geste d’écriture à donner [a donné] de l’espace la même [à une] forme d’ignorance face à mon propre discours, je suis spectateur de ces [ce] discours dont je ne connais pas la forme finale qu’il prendra. Je suis surpris, malgré tout, comme devant le [un] spectacle.
Danse disco [Dans ce discours] produit, je relève plusieurs intentions comiques et tragiques. Dans une veine comique, je peux dire que les transformations que perd [qu’opère] la machine mais [me] font souvent rire. Par exemple, dans mon en production [introduction], au lieu de dire [que j’avais utilisé avec Paul] que je vais utiliser avec Paul, la machine dit « Que Jésus va utiliser avec Paul pour carnet de bord. »
L’absurdité de la transcription est comique à plusieurs niveaux. D’abord par l’introduction inopinée de Jésus dans un texte qui ne traite pas de sentiments religieux. De ces faits [ce fait], pôle [Paul,] dont le nombre [nom] n’a pas été modifié, gagne en quelque sorte en [une] dimension Bling [biblique] dans cette phrase, où j’ai envie de l’associer à l’apôtre. La machine a créer [créé] une parodie accidental [accidentelle] de la Bible, où Jésus écrit un carnet de bord comme les étudiants dartek [d’ArTeC], mais aussi une parodie de moi-même ou [où] ce discours prendre [prend] une dimension comique ment [comiquement] messianique. C’est peut-être une belle et drôle image pour décrire rétrospectivement mon état d’esprit de l’époque, où j’étais dans l’attente d’une idée miraculeuse. Même si tout cela reste interprétative [interpretatif], c’est drôle de voir que la machine semble avoir eu l’intention [l’intuition] de ce moment. Il y a beaucoup d’autres exemples comiques, surtout quand la machine mais contrat dit [me contredit,] par exemple au lieu de [« il m’était impossible »,] elle transcrit joliment par [« il m’était en possible »] (voir Introduction), comme si elle croyait plus en mon discours que moi-même. Un peu plus moi [loin] dans ce mémoire, le logiciel me montre à nouveau qu’il est plus sûr que moi. Entr, inscrivant [En transcrivant] « inexacte » par « inexistante », la machine éradique la possibilité même de l’existence du doute. Le doute dans ce cas-là, ne fait pas partie de son vocabulaire et relève de la fiction.
Outre cet aspect comique qui saute souvent aux yeux, ce travail compte aussi une vraie dimension [tragique]. La matière même de ce texte renvoie à une dimension [tragique]. C’est un texte fait des doutes, des points d’interrogation, enserré [insérés] par la machine dès que sa compréhension n’est pas optimale. Ces doutes sont un facteur dans sécurité [d’insécurité] textuelle et une manifestation de l’immensité des interprétations possibles, dont la mesure donne le vertige. Cet état d’incertitude permanente marque existentiellement ce parcours de recherche (Sadin 2018, 97).
Je dirais même que le doute est encore plus fort lorsque je suis en train de dicter ce discours à la machine, puisque je vois **** excessivement [successivement] apparaître et disparaître des possibilités de transcriptions que le logiciel juge non pertinentes ou Inexistante [inexactes]. En disparaissant tragiquement, ces possibilités sont oubliées dans une sorte d’une lampe [de limbes] de l’algorithme ou [où] je ne pourrai jamais les revoir.
J’ai choisi, pour illustrer ses [ces] hésitations permanentes [du] logiciel, de faire des captures d’écran réalisées en même temps que je lisais le paragraphe précédent.
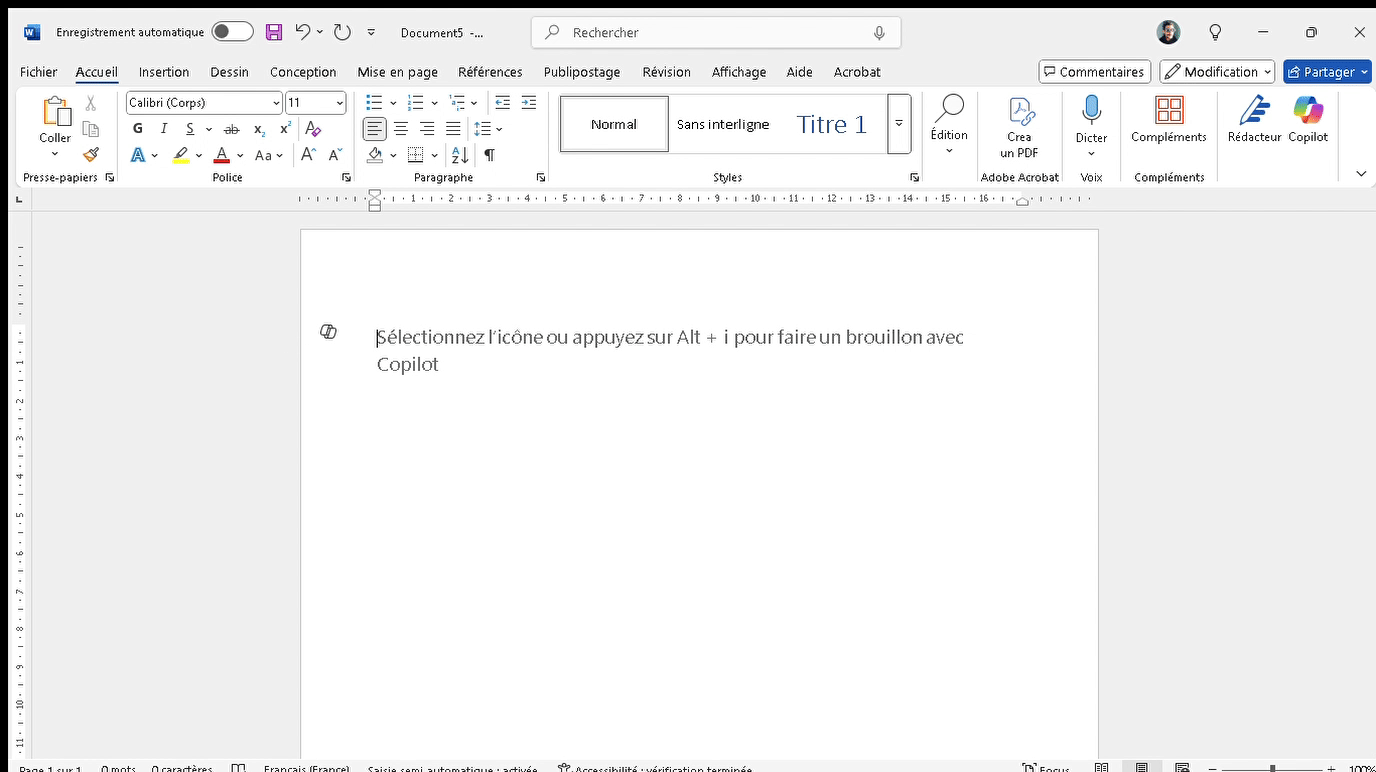
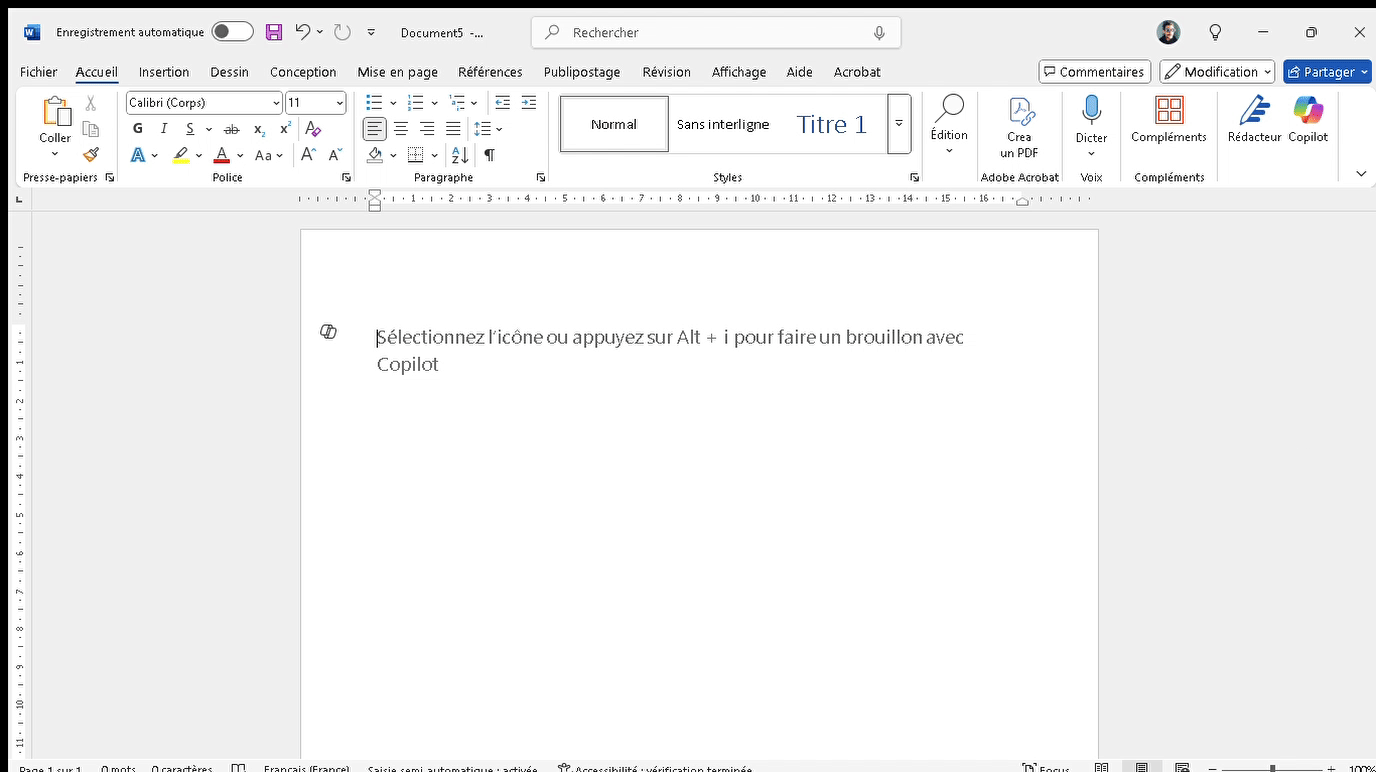
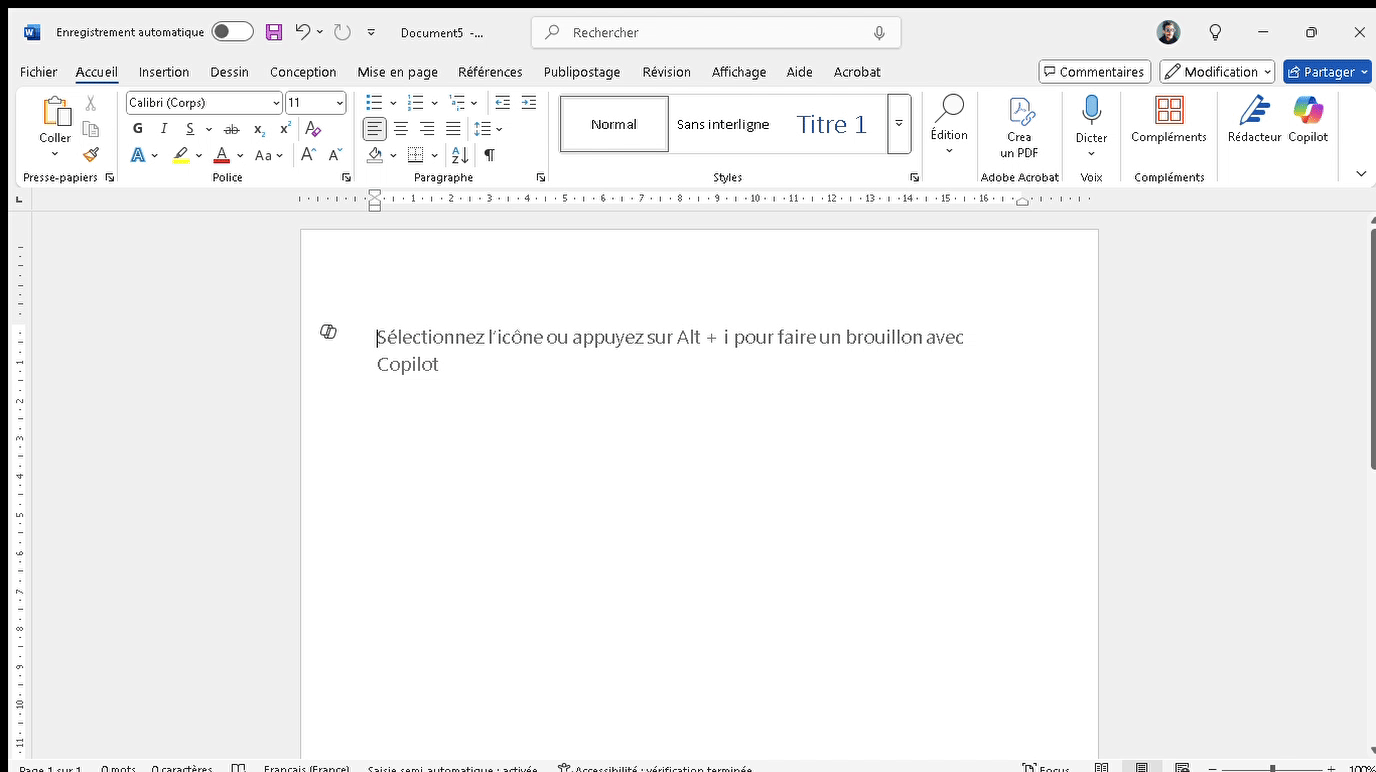
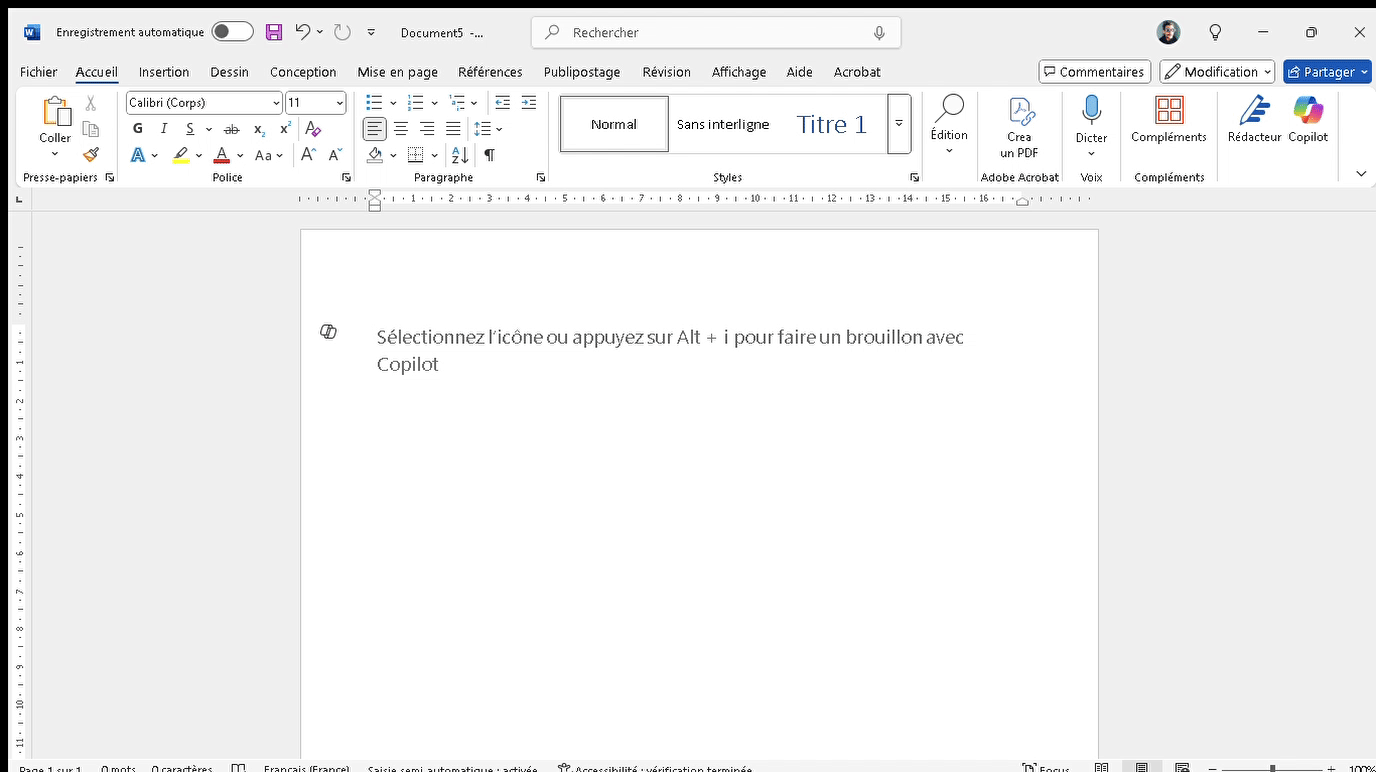
J’ai [Je] constate d’abord que le gris clair est la couleur réservée à l’incertain, à ce qui n’est pas encore affirmatif. J’ai réussi à capturer le moment avant la censure où « successivement » est compris comme « sexy sue ». Ensuite, ce groupe de mots est remplacé par des astérisques, et donc, Oublia [oublié à] jamais. Même constat par [pour] « inexacte » que le logiciel comprend d’abord comme « il existe », j’ai [je n’ai] malheureusement pas pour [pu] capturer cet instant fugace, oui [puis] comme « inexistant ». Je trouve ce que ce motif de circulation du sang [l’oscillation du sens], du doute et de la perte ont une forte connotation tragique.
En effet, [ce mémoire] avant [a une] fonction à la fois existentielle et cathartique pour moi. En écrivant [ce mémoire], je me libère du poids des études, du poids de mes obsessions. C’est aux formes de bouche [une forme de purge] de mon propre discours. Toujours en relation avec le théâtre antique, je peux dire que la place donnée à la parole en excès a quelque chose à voir avec libris [l’hybris]. Tout ce qui a [est] dit est reporté, dans une forme de démesure du discours. Aussi, la retranscription me confronte à des paradoxes, des tensions incompatibles que je dois tenter de résoudre.
L’ordinateur a vraiment un effet Deus Ex Mac [deus ex machina] pour moi dans la mesure [où] elle vient résoudre une situation que je tenais pour en soluble [insoluble]. L’ordinateur MOF [m’offre] des moments de découverte, de résolution comparable au moment [comparables aux moments] de dénuement où le personnage [les personnages] se confrontent avec les résultats dans [d’une] situation tragique. En plus, l’action des marées [de narrer] ce mémoire en renforce la dimension entre spective [introspective] et autre réflexive [autoréflexive] ce qui me ramène encore une fois au personnage de Hamlet qui apprendre [appréhende] à la fois le monde et son individualité.
L’action de la machine sur mon discours fait ainsi ressortir des dimensions théâtrales que je ne pensais pas nécessairement expérimenté [expérimenter] en écrivant ce mémoire.
Penser théâtralement l’utilisation, la pratique et les résultats de la technologie et analyser théâtralement la relation à la technologie me permet de développer d’autres manières de créer et d’articuler l’humain et la machine. C’est ouvrir la Sion [une relation] que je vais approfondir dans la 3e suis partie [troisième sous-partie] ou j’envisagerai la dimension performative de cette relation ? [.]
C’est. [C.] Performer lisible [l’illisible]
L’exploration des potentiels teatro [théâtraux] de cette expérience d’écriture de ce mémoire me porte naturellement à approfondir la dimension performative de ce travail. Pour cela, je vais me confronter à toutes [tous] les sens du mot « performance ».
Le premier sens que je peux donner le [au] terme de performance et [est] celui d’exploit suivant Sportive [sportif,] de puissance mécaniqueJe reprends cette définition au CNRTL : « Résultat obtenu par un(e) athlète, une équipe dans un épreuve sportive, et p. ext., un exploit sportif » ; « indications chiffrées, courbes, concernant les caractéristiques mécaniques (puissance, vitesse, autonomie) d’un véhicule ou les possibilités de vol d’un avion. »↩︎. C’est ensemble [un sens] qui est souvent évacué de la sphère artistique. On peut néanmoins c’était [citer] les futuristes. [,] entre autres, qui ont et concilier [réconcilier] ses [ce] sens de la performance et celui de la création artistique.
On mange cru voir [En m’inscrivant] dans cette interprétation de la performance, je peux dire qu’on parle souvent, des manières productivistes [de manière productiviste,] d’une bonne [ou] d’une mauvaise machine en fonction de ses performances. Or ? C’est [Or, ce] présent travail me permet de réfléchir indirectement sur ce qu’on attend d’une bonne performance mécanique et technologique. On estime qu’une intelligence artificielle, ou toute technologie avancée en général, est performante dans la mesure où elles répondent [elle répond au] mieux à nos attentes, en les devançant intuitivement. Mais en retour, moi aussi en tant qu’étudiant-artiste, je dois me montrer le site [aussi] performant pour travailler avec la machine, afin qu’elle réponde au mieux à mes expectatives. Je dois maîtriser ma prononciation, je dois contrôler mon débit de parole, sinon la machine ne me comprendra pas. C’est en [un] double-effet de la notion de performance, où la machine est prête à performer et si elle n’y parvient pas, c’est qu’elle n’est pas assez performante ou que les conditions ne sont pas réunies pour qu’elle performe bien, tandis que si je ne mets [me] montre pas ses [assez] performances [performant] de mon côté, je peux certes m’en prendre à la machine et l’ampoule [l’inculper], mais une partie de la culpabilité me reviendra toujours.
Cette relation entre moi et la machine m’envoie qu’une [m’évoque une] sorte de doppelganger. La machine devient en [un] double magique et maléfique, qui me montre mes défauts, c’est un double entre écrit et **** [oral,] interne et externe, le discours et sa rentre. Inscription [retranscription]. En quelque mots [sorte], mon usage de ce logiciel est contre-performatif, puisque je me limite à une seule des nombreuses fonctionnalités proposées par Word, C’est le [celle] de la dictée vocale ? [.] Les seules autres actions que j’ai accomplies [j’accomplis] à travers la machine, ce sont des actions de mise en forme basiques, comme copier, coller, modifier la largeur des marches [marges]. Dans l’interface de toutes les possibilités proposées par Word, ce mémoire aurait pu prendre une forme bien différente, en termes de design général, d’intégration, d’image, de typographie […] Cette relation de doppelganger me permet de réaliser une cyber-performance dans ma relation à la machine, par laquelle je cherche à étendre ma subjectivité, à l’intégrer technologiquement afin de définir de nouveaux modèles de lecture, de compréhension, de dramaturgie hé. XX. [etc.].
J’ai choisi de faire écrire ce texte en one shot, d’une seule [d’un seul] coup ? [,] Afin de mettre en lièvre [en relief] ces différentes qualités de performance. Sami [Ça me] place un peu comme sur une scène où une fois le texte dit, je peux certes me corriger, mais je ne peux pas revenir en arrière. [,] Car tout a été transcrit [est retranscrit]. J’ai choisi [Je choisis] volontairement d’abandonner une des forces de l’écrit, celle de pouvoir réorganiser, recorriger, revenir sur le texte avant sa publication, afin de rendre justice à la nature hybride de ce travail, à la fois écrit, **** [oral] être transcrit [et retranscrit]. Cette dimension mais il puisse [me pousse à] être plus performant dans mon discours, je n’ai qu’une seule chance pour bien le dire.
Cet aspect de la performance, d’exploit [du] discours me porte à approfondir la connotation politique de ce geste hybride. Parler à voix haute m’y [me] fait penser à l’univers de la rallonge [harangue,] Toi [de l’art oratoire,] de l’éloquence politique. J’organise le [au] mieux mes idées pour les rendre efficaces, audible [audibles], expressif [expressives]. Ce discours a en effet un objectif, c’est [celui de] vous convaincre de l’intérêt de cette démarche artistique. Français, la [En cela,] le fait de parler à une machine exacerbe ce problème de communication. Ce qu’écrit. Secret trans, prix [ce que retranscrit] la machine est comparable ceux [à ce] que la machine a compris de mon discours. Je peux supposer qui [que] m’ont [moins] le texte [est] lisible, moins le discours original [originel] est clair et compréhensible. La machine me montre que mon discours est compréhensible autrement. [,] Tout comme mon discours pour [pourrait] être plus ou moins compris par les spectateurs, en fonction de [l’]expressivité, l’intensité du discours, mais aussi l’intérêt que les spectateurs il porte [y portent]. Les idées [qui] me paraissent importantes ne sont pas nécessairement celles qui seront bien et transcrits [retranscrites] par la machine et par conséquent, celles retenues par le spectateur. L’ordinateur à qui je parle est mon premier spectateur. Il m’écoute et me voir [voit,] à travers la caméra. Si on est [C’est un] spectateur ça encore [sans corps,] mais avec ses [des] yeux et des oreilles. On dit souvent que les gouvernements russes [russe,] américains [américain] ou chinois ? [,] nous espionnent à travers nos caméras, pour épier nos faits et gestes. C’est sûrement abusive [abusif], mais cette hypothèse laisse entendre qu’il [qu’] une ou plusieurs personnes ont écouté ses [ce] discours par écrans interposés en [m’] espionnant. Cette hypothèse donne aussi en [un] effet de télé-réalité à mon travail, on fr [un effet] réseau social, où je dois présenter la meilleure facette de ma personnalité et de mon discours.
Cette possibilité de l’espionnage renforce la nécessité de bien performer le discours et révèle la construction de soi, à l’œuvre dans la construction du discours.
Bien évidemment, ce travail s’est lié [se lie] également avec une dimension plus artistique et dans le mystique [linguistique] de la notion de performance. La performance est à la fois la « réalisation d’un acte de langage » et « un événements [événement] artistique associant diverses formes d’expression et dont le déroulement en présence d’un public constitue Louvre [l’œuvre] elle-mêmeJe reprends cette définition au CNRTL, dictionnaire en ligne : http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/performance↩︎. » Alors c’est [Or ce] travail, c’est basé [se base] à la fois sur le langage, le moment de son énonciation et sur l’action. La machine crée quelque chose d’unique car si je répète mon texte, il ne sera pas identique au précédent. C’est un geste unique paradoxalement, irai productible [irreproductible], à l’instar de nombreux gestes performatives [performatifs] qu’on ne pourrait reproduire avec exactitude, car ce geste renvoie [ces gestes renvoient] au moment et au contexte précis de la résurrection [de leur exécution], comme la performance chute [Shoot] de Chris boardman [Burden], de 1971. Il est intéressant de voir que le logiciel a eu une sorte d’intuition en parlant de « résurrection » plutôt que des élections [« exécution »] justement à propos d’un performant [performeur] qui survit à un tir de balle.
Si je veux être plus précis, je pense que c’est [ce] travail relève plutôt des enregistrements [de l’enregistrement] d’une performance dont le texte est l’archive. Cet aspect pose la question de la reproduction de ce travail. Je peux [l’]imprimer en plusieurs exemplaires qui sont autant de témoignages d’une performance passée, que seule [une] nouvelle lecture-transcription permettrait de refaire, sans pour autant parvenir à produire quelque chose d’identique.
Dans ces dispositifs [ce dispositif], j’engage mon corps et mon aide sociale [être social] à travers ma voix, ma prononciation, mais l’entité qui exécute, qui redouble la performance, c’est la machine. Ces dispositifs permettent [Ce dispositif permet] ainsi de diversifier les pratiques de la performance qui sont souvent centrés [centrées] sur un acteur unique, vous valorisez [ou valorisé] hiérarchiquement. Ici, finalement, la répartition humain/machine dans la création commune est assez horizontale car interdépendante. Le geste performatif dépend aussi bien de moi que du logiciel.
Semez moi [Ce mémoire] s’il [se] veut donc être à la fois une mise à l’épreuve de [mes] capacités, de [mes] performances et celles de la machine, justement à travers un geste performatif qui est co-construit. Nous performant [performons un] savoir que j’appelle illisible, dans la mesure ou [où] je sais que sa réception on Serra partiel [en sera partielle], en donnera une autre image, comme lorsqu’on prendre [prend] en photo une performance, une image partielle fondée sur des traces. Mais aussi, ce travail est illisible dans la mesure où il me [ne] prend pas la forme habituelle d’un mémoire ou de tout autre texte académique.
Ce travail redéfinit les limites entre un savoir véhiculer [véhiculé] de manière Soupe the Man universel [supposément universelle], intelligible, rationnel [rationnelle] et en [un] savoir ésotérique, Bon, ça va individuel ? [un savoir individuel,] un savoir d’expérience ?[,] comment savoir irrationnelle ? [un savoir irrationnel.] En effet, le savoir qui est ici mis en valeur est un savoir dès [de] l’instant qu’on immortalise, de l’archive, de sécurité [ce qui aurait été] perdu sans la transcription. La réception de ce travail est une activité qui relève à la fois de la Ré, construction de deux centres membres [reconstruction, du décentrement] et de la déconstruction. Chaque lecteur ne chercheraient [cherchera] pas à comprendre ce texte selon les mêmes standards de lecture. Certains seront plus sensibles à la dimension graphique, d’autres à la dimension sonore du texte, et d’autres tenteront de reconstruire le sens rationnellement. Étant donné que même les citations empruntées à d’autres textes sont modifiées par le logiciel de retranscription, il est plus difficile de se baser sur un savoir préétabli. En somme, le lecteur doit digérer le texte sinon [selon] ses propres savoirs, ses propres intuitions, pour apprendre [appréhender] le texte. Dans cette activité de lecture, ce qui valoriser [est valorisé], c’est moins la capacité à comprendre une théorie que d’exercer son intuition, sa capacité à [l’]interprétation. En plus, vu que ce texte ne sais pas [ne se veut pas] être uniquement un discours théorique sur les relations entre théâtre et technologie, mais là [la] restitution d’une expérience mettant en résonance ces deux domaines, le lecteur comprend par la lecture qu’à ce moment précis, une expérience a donné tel résultat. C’est une lecture qui est un peu comparable à l’expérience de contemplation des photographies dont parle Roland Barthes (2016) dans la chambre claire [La chambre claire]. Ce texte ? [,] c’est ampoule [un peu le], « ça a été » d’une performance, qui est à la fois présente et différée. Ce « ça a été » ampli que si [implique aussi] une forme de nostalgie, [d’]attachement sentimental vers se passer [ce passé], car ce texte est le témoignage d’une machine, d’essai [de ses] performances, et il se peut très bien que de inventant [dans vingt ans,] la machine n’efface [ne fasse] plus aucune héros [erreur] et comprennent [comprenne] toutes [tous] les exactions [accents] et toutes les prononciations. À l’inverse dans ce texte, j’ai choisi de valoriser les chèques [l’échec,] de le montrer et de l’intégrer pleinement au discours, contrairement au texte classique [aux textes classiques] de savoir où l’erreur est évacuée, mise à distance pour privilégier ce qui est conforme à la théorie d’ensemble. La machine redouble l’échec et mais [met] Constantin [constamment] en doute ma parole à travers des points d’interrogation partout.
C’est là que je vois à nouveau un potentiel politique à cette illisibilité relative du texte. Elle rentre [rend] ce savoir opaque, et on c’est là [en cela] le protège des réappropriations. Mais aussi, elle amène le lecteur à douter de ce qui est écrit alors qu’habituellement, le public universitaire pour [peut] relativement s’est fié [se fier] à un texte présenté comme académique. Mais le doute inscrit dans le texte permet aussi d’inclure le lecteur dans les projets [le projet] en présentant [pressentant] ses interrogations et ses incompréhensions. C’est une manière de capter son attention. Cette exacerbation du doute performer [performée] par la machine et [est] au centre de l’écriture. Moi-même je me pose constamment la question d’être compris, d’être compréhensible, de me corriger. C’est un doute hyperbolique, par Loïc [paranoïaque,] Délirants. [délirant,]. De temps [d’autant] plus que je ne peux pas contrôler les 2 [doutes] de la machine. Bon, c’est là [En cela], je dirais que ce dispositif pousse à l’extrême toutes les questions qui [que] nous font les machines : « Voulez vu [-vous] un reçu ? »
« Avez-vous lu nos conditions de vente ? » « Acceptez-vous les cookies ? ». Cette manière qu’ont les machines de smiley [semer le] doute en nous est en [une] manière d’arracher en [un] consentement. C’est donc un doute constant et redoublé par la machine. J’ai [Je] m’éloigne aussi de [ainsi du] doute hyperbolique cartésien dans les médiations métaphysiques ? [Médiations métaphysiques,] dans la mesure eu [où] mon doute est la matière même du discours (Descartes et Pellegrin 2009). Ce n’est pas en [un] doute maîtrisé ou limité dans le temps, et il ne vise pas [à] trouver une vérité stable sur laquelle fonder des [les] sciences. Je cherche au contraire à performer le doute et [à] l’approfondir et à lui conférer une force de savoir. On pourrait dire que c’est [ce] doute exagéré pour réduire en [pourrait nourrir une] forme de complotisme ? [.] Mais c’est un doute si total, si constant qu’ils [qu’il] ne parviennent [parvient] pas à faire système et à fournir suffisamment d’éléments concordants pour alimenter et favoriser une hypothèse sur l’autre.
Il est donc intéressant de voir que ce dispositif humain/machine mais [me] permet d’embrasser plusieurs aspects de la notion de performance qui s’alimentent les uns aux autres. Cela me permet d’éclairer dans quelle mesure la machine ? [Ø] Mais [me] force en retour à être performant ? [.] Merci auto [Mais surtout,] ce geste informative [performatif] retranscrit et différé me permet de porter un témoignage de ce qui a été et ne sera plus. C’est la matérialisation sensible d’or du [d’heures de] travail et de recherches ou [où] les doutes persistent [le doute persiste] et confère paradoxalement une certaine force d’inclusion dans [à] mon discours. Performance, lisibilité [Performer l’illisibilité] dessus [de ce] savoir transcrit, ses enfants [c’est enfin] une manière de le protéger et de valoriser d’autres manières d’apprendre [d’appréhender] le savoir.
L’idée de performance enfant [enfin], renvoyé [renvoie] à la fonction performative du langage ? [.] En effet, ce texte fou et théâtral ne fait pas que transcrire un discours. Il crée aussi une réalité et lui donne vie. Je pense notamment aux nombreux personnages et aux espaces que le logiciel crée de toutes pièces et qui peuplent poétiquement, j’y reviendrai en dernière partie, la page et le discours.
| Personnages | |
|---|---|
| Jean Provise | Bien Fabre |
| Paul Guttman | Tiffany sa maillot |
| Henri Team | Adam |
| Agatha | Césaire |
| Nasri | Enrique |
| Miss | Simon |
| M Aperçois | Maxime |
| Élise Régina. | Tiffany tu fais une Mayo |
| Tiffany Samouraï, | Tiffany ça mailloux |
| Annie Thorson | Swan |
| Alain vers | Nonaka |
| Hassan | Maurice TIC |
| Fatou | Lamachi |
| Claude Charneau | Steve et Stich |
| Claude Karine | Sami |
| Tiffany Sama | Constantin |
| Jesus | Loic |
| Béatrice Franck | Chris boardman |
| Clarisse | Laura Yo |
| Tony | Joseph Québec |
| Boutillier | Luz Loucedé |
| Lieux |
|---|
| Valdir City |
| Ohio |
| Rio |
| Mans |
| Nord |
| Moulins |
| Lyon |
| Ré |
| Serra |
| Sion |
| L’Oise |
| États-Unis |
La 2e [deuxième] partie de ces mémoires [ce mémoire] a donc permis d’étudier les potentiels teatro [théâtraux] de lisibilité [l’illisibilité] de cet expert formé [ce texte performé]. C’est un texte fou, qui fait valoir en [un] savoir qui est autre, un savoir encoder [encodé et] mystérieux, ce que reflète notamment ma difficulté à approcher les relations entre théâtre et technologie. C’est un texte qui dispense son [un] savoir évolutif dans le temps et l’espace, ont [un] texte qui a subi des modifications, desquels [desquelles] surgissent des situations à la fois comiques et tragiques, et dont le monde [mode] des créations [de création] à la fois **** [oral] et écrit, rattache ce texte à l’univers du théâtre et de la politique. Mais c’est sûrement toutes les dimensions de la notion de performance que je me permets décernée au milieu [qui me permettent de cerner au mieux] la portée de ce travail de recherche et création. J’aime à penser qu’il tient [en] partie de la photographie d’un moment de la technologie et qu’il participe d’une revalorisation du doute dans le discours qui dépasse l’opposition entre vérité établie et complot, fake news ? [.]Je trouve intéressant que la machine redouble le doute du complot et de la fake news en intégrant une marque de doute, comme si elle savait de quoi on parle et que l’on parle d’elle indirectement.↩︎ Séance de [C’est un] travail qui pose la question : que faire de tous ces doutes, et de comment préserver une certaine énergie du doute ? [.]
Dans la 3e [troisième] partie de ce travail, j’en ai les oreilles [j’analyserai] comment la dimension poétique de ce texte transcrit permet justement de contrebalancer lisibilité [l’illisibilité] et les doutes ? [le doute,] en redynamisant les interprétations par l’intégration d’une lecture qui est autre et qui prend en considération la dimension sonore et partiellement autobiographique de ce texte. Je m’interrogeais [m’interrogerai] sur cette poésie créé [créée] par la machine.